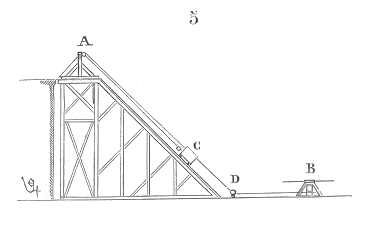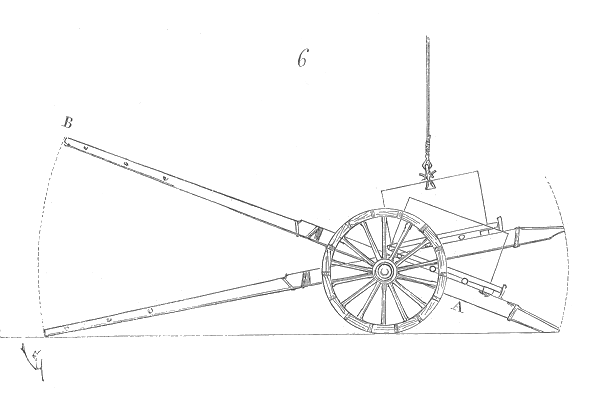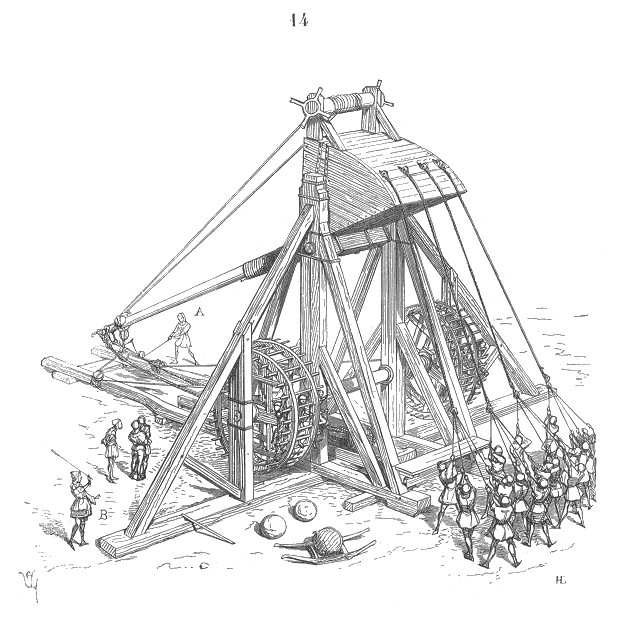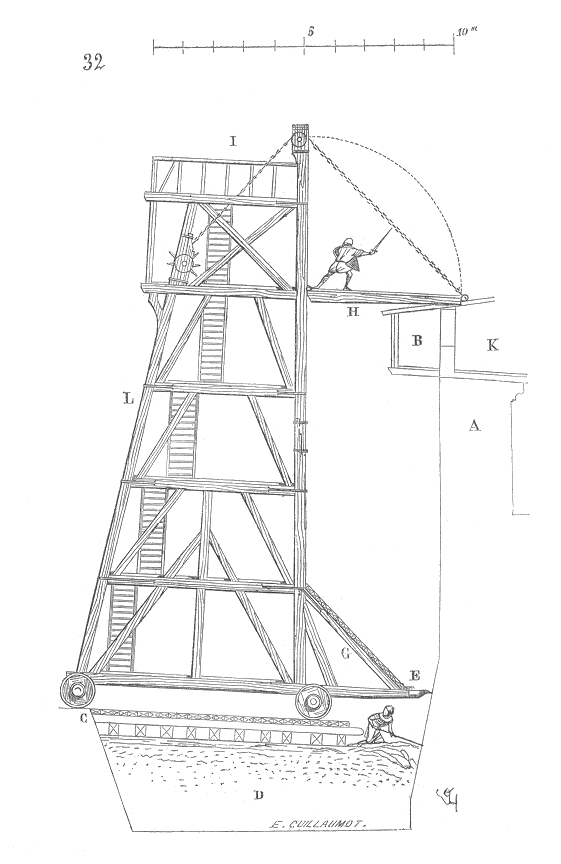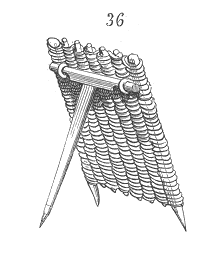La bibliothèque libre.
s. m. On donnait ce nom à toute machine; d'où est venu le mot engineor, engingneur, pour désigner l'homme chargé de la fabrication, du montage et de l'emploi des machines; d'où le nom d'ingénieur
donné de nos jours à toute personne occupée de
l'érection des ponts, du tracé des voies, de la
construction des usines, des machines, des navires, des fortifications,
etc.; d'où enfin le nom de génie donné au corps.
Parmi les engins du moyen âge, il y a les engins
employés pour un service civil, comme les engins propres
à monter ou transporter des fardeaux, les grues, les
chèvres, les treuils, les machines hydrauliques, les presses;
puis les engins de guerre, lesquels se divisent en engins offensifs,
engins défensifs et engins à la fois offensifs et
défensifs.
Il est certain que les Romains possédaient des machines
puissantes pour transporter et monter les matériaux
énormes qu'ils ont si souvent mis en œuvre dans leurs
constructions. Vitruve ne nous donne sur ce sujet que des
renseignements peu étendus et très-vagues. Les Grecs
étaient fort avancés dans les arts mécaniques; ce
qui ne peut surprendre, si l'on songe aux connaissances qu'ils avaient
acquises en géométrie dès une époque fort
ancienne et qu'ils tenaient peut-être des Phéniciens.
Depuis l'antiquité, les puissances mécaniques n'ont pas
fait un pas; les applications seules de ces puissances se sont
étendues, car les lois de la mécanique dérivent de
la géométrie; ces lois ne varient pas, une fois connues;
et parmi tant de choses, ici-bas, qu'on donne comme des
vérités, ce sont les seules qui ne peuvent être
mises en doute.
Les anciens connaissaient le levier, le coin, la vis, le plan
incliné, le treuil et la poulie; comme force motrice, ils
n'employaient que la force de l'homme, celle de la bête de somme,
les courants d'air ou d'eau et les poids. Ils n'avaient pas besoin,
comme nous, d'économiser les bras de l'homme, puisqu'ils avaient
des esclaves, et ils ignoraient ces forces modernes produites par la
vapeur, la dilatation des gaz et l'électricité. Le moyen
âge hérita des connaissances laissées par les
anciens sans y rien ajouter, jusqu'à l'époque où
l'esprit laïque prit la tête des arts et chercha des voies
nouvelles en multipliant d'abord les puissances connues, puis en
essayant de trouver d'autres forces motrices. De même qu'en
cherchant la pierre philosophale, les alchimistes du moyen âge
firent des découvertes précieuses, les mécaniciens
géomètres, en cherchant le mouvement perpétuel,
but de leurs travaux, résolurent des problèmes
intéressants et qui étaient ignorés avant eux ou
peut-être oubliés; car nous sommes disposé à
croire que les Grecs, doués d'une activité d'esprit
merveilleuse, les forces motrices de leur temps admises seules, avaient
poussé les arts mécaniques aussi loin que possible.
[modifier] ENGINS APPLIQUÉS À LA CONSTRUCTION
Nous voyons, dans des manuscrits, bas-reliefs et peintures du IXe au XIIe
siècle, le treuil, la poulie, la roue d'engrenage, la romaine,
les applications diverses du levier et des plans inclinés. Nous
ne saurions préciser l'époque de la découverte du
cric; mais déjà, au XIVe siècle, son principe est parfaitement admis dans certaines machines de guerre.
D'ailleurs chacun sait que le principe en mécanique est
celui-ci, savoir: que la quantité de mouvement d'un corps est le
produit de sa vitesse, c'est-à-dire de l'espace qu'il parcourt
dans un temps donné, par sa masse; et une fois ce principe
reconnu, les diverses applications devaient s'ensuivre naturellement,
avec plus ou moins d'adresse. Dans les constructions romanes, on ne
voit guère que de petits matériaux employés,
matériaux qui étaient montés soit à
l'épaule, soit au bourriquet au moyen de poulies, soit en
employant le treuil à roues que des hommes de peine faisaient
tourner par leur poids (1). Cet engin primitif est encore mis en
œuvre dans certains départements du centre et de l'ouest
de la France; il est puissant lorsque la roue est d'un diamètre
de six mètres, comme celle que nous avons tracée dans cet
exemple, et qu'on peut la faire mouvoir par la force de trois hommes;
mais il a l'inconvénient d'occuper beaucoup de place,
d'être d'un transport difficile, et il ne permet pas de
régler le mouvement d'ascension comme on peut le faire avec les
machines de notre temps employées aux mêmes usages. Le
seul moyen de donner une grande puissance aux forces motrices autrefois
connues, c'était de les multiplier par les longueurs des
leviers. Aussi, pendant le moyen âge, comme pendant
l'antiquité, le levier joue-t-il le principal rôle dans la
fabrication des engins. Les Romains avaient élevé des
blocs de pierre d'un volume énorme à une grande hauteur,
et ils dressaient tous les jours des monostyles de granit ou de marbre
de deux mètres de diamètre à la base sur quinze
à dix-huit mètres de hauteur. Les Phéniciens et
les Égyptiens l'avaient fait bien avant eux; or de pareils
résultats ne pouvaient être obtenus que par la puissance
du levier et les applications très-étendues et
perfectionnées de ce moyen primitif.
On comprend, par exemple, quelle puissance peut avoir un engin
disposé comme celui-ci (2). Soit AB un monostyle posé sur
chantier incliné ayant en C un axe roulant dans une entaille
longitudinale pratiquée dans une forte pièce de bois E,
que l'on calle en X lorsque le chantier est arrivé à sa
place; soient, assemblées dans l'axe et les pièces
inclinées, deux bigues CD, réunies à leur sommet D
comme un pied de chèvre, ainsi que le fait voir le tracé
P; soient des écharpes en bois G, puis un système de
haubans en cordages H fortement serrés par des clefs; soient, le
long des deux bigues, des poulies K, et sur le sol, fixées
à deux pièces longitudinales, d'autres poulies
correspondantes L dont les dernières renvoient les câbles
à deux cabestans placés à distance. Il faudra que
le monostyle AB, si pesant qu'il soit, arrive à décrire
un arc de cercle et à prendre la position a b; on
passera sous son lit inférieur des calles ou un bon lit de
mortier, et lâchant les cordes qui le lient peu à peu, il
glissera sur son chantier et se posera de lui-même sur sa base M.
Il ne s'agit que d'avoir des bigues d'une dimension
proportionnée à la hauteur du bloc à dresser et un
nombre de poulies ou de moufles en rapport avec le poids du bloc. C'est
ce même principe qui est adopté de temps immémorial
dans la construction des petits fardiers (2 bis) propres à
soulever et transporter de grosses pièces de bois.
Mais il était fort rare que les architectes du moyen
âge missent en œuvre des monostyles d'une dimension telle
qu'elle exigeât de pareils moyens. Pour élever des
colonnes monolithes comme celles de la cathédrale de Mantes, de
l'église de Semur en Auxois, du chœur de l'église
de Vézelay, de la cathédrale de Langres, etc., les
architectes pouvaient n'employer que le grand treuil à levier
que nous voyons figuré dans les vitraux et dans les vignettes
des manuscrits. Ce treuil, malgré son volume, pouvait être
transporté sur des rouleaux, et s'il ne s'agissait que
d'élever les colonnes d'un sanctuaire, il n'était besoin
que de lui faire faire une conversion, de façon à placer
son axe normal à la courbe du chevet1.
Voici (3) un de ces engins que nous avons essayé de rendre
pratique, car les tracés que nous donnent les peintures
anciennes sont d'une naïveté telle qu'on ne doit les
considérer que comme une indication de convention, une
façon d'hiéroglyphe. En A, on voit le plan de l'engin,
dont le treuil horizontal B est disposé de manière
à pouvoir enrouler deux câbles. Le profil D de cet engin
montre l'un des deux plateaux circulaires C du plan, lesquels sont
munis, sur chacune de leurs faces, de huit dents mobiles, dont le
détail est présenté en G de face et de profil. Les
grands leviers E sont à fourchettes et embrassent les plateaux
circulaires; abandonnés à eux-mêmes, ces leviers
prennent la position KL, venant frapper leur extrémité
sur la traverse L, à cause des contre-poids I. Alors les dents
M, tombées sur la partie inférieure de leur entaille, par
leur propre poids et la position de leur axe, opposent un arrêt
à l'extrémité de la flèche du levier entre
la fourchette; les hommes qui, étant montés par
l'échelle N, posent leurs pieds sur la traverse O, en tirant,
s'il est besoin, sur les échelons, comme l'indique le personnage
tracé sur notre profil, font descendre l'extrémité
du levier O jusqu'en O'. Le plateau a ainsi fait un huitième de
sa révolution et les câbles se sont enroulés sur le
treuil. Abandonnant la traverse O, le levier remonte à sa
première position, sous l'action du contre-poids; les hommes
remontent se placer sur la traverse, et ainsi de suite.
L'échelle N et la traverse O occupant toute la largeur de
l'engin entre les deux leviers, six hommes au moins peuvent se placer
sur cette traverse façonnée ainsi que l'indique le
détail P, et donner aux leviers une puissance
très-considérable, d'autant que ces hommes n'agissent pas
seulement par leur poids, mais par l'action de tirage de leurs bras sur
les échelons. Dans le détail G, nous avons figuré,
en R, une des dents tombée, et, en S, la dent correspondante
relevée. Ces sortes d'engrenages mobiles, opposant une
résistance dans un sens et s'annulant dans l'autre, prenant leur
fonction de dent par suite de la position de la roue, sont
très-fréquents dans les machines du moyen âge.
Villard de Honnecourt en donne plusieurs exemples, et entre autres dans
sa roue à marteaux, au moyen de laquelle il prétend
obtenir une rotation sans le secours d'une force motrice
étrangère.
Le vérin, cet engin composé aujourd'hui de fortes
pièces de bois horizontales dans lesquelles passent deux grosses
vis en bois qui traversent l'une des deux pièces et d'un
pointail vertical qui les réunit, était employé,
pendant le moyen âge, pour soulever des poids
très-considérables, et a dû précéder
le cric. Villard de Honnecourt donne un de ces engins2
dont la puissance est supérieure à celle du cric, mais
aussi est-il beaucoup plus volumineux (4). Une grosse vis en bois
verticale, terminée à sa partie inférieure par un
cabestan, passe à travers la pièce A et tourne au moyen
des pivots engagés dans la sablière B et dans le chapeau
C; deux montants inclinés relient ensemble les trois
pièces horizontales. Deux montants à coulisses D
reçoivent, conformément à la section E, un gros
écrou en bois dur armé de brides de fer et supportant un
anneau avec sa louve F. En virant au cabestan, on faisait
nécessairement monter l'écrou entre les deux rainures des
montants D, et l'on pouvait ainsi soulever d'énormes fardeaux,
pour peu que l'engin fût d'une assez grande dimension.
L'emploi des plans inclinés était
très-fréquent dans les constructions de
l'antiquité et du moyen âge; nous en avons donné un
exemple remarquable à l'article Échafaud(fig.
1 et 2). On évitait ainsi le danger des ruptures de câbles
dans un temps où les chaînes en fer n'étaient pas
employées pour élever des matériaux d'un fort
volume, et
on n'avait pas besoin d'employer des puissances motrices
extraordinaires. Il est certain qu'au moyen d'une trémie
élevée suivant un angle de 45 degrés, par exemple
(5), deux poulies étant placées au sommet en A, deux
autres poulies de renvoi en D, et un ou deux cabestans en B, le poids C
étant posé sur des rouleaux, on épargnait beaucoup
de forces; mais il va sans dire que cette manière
d'élever des matériaux propres à la construction
ne pouvait s'employer qu'autant que les bâtiments n'atteignaient
qu'une hauteur très-médiocre: or les édifices du
moyen âge sont souvent fort élevés. Aussi, pour la
construction des œuvres hautes de ces édifices,
paraît-il que l'on employa la chèvre et la grue. Il
existait encore, vers le commencement de notre siècle, sur le
clocher sud de la cathédrale de Cologne, alors
élevée au niveau des voûtes hautes de la nef
environ, une grue soigneusement recouverte d'une chape en plomb et qui
datait du XIVe
siècle, c'est-à-dire du moment où les travaux
avaient été interrompus. Nous ne possédons pas,
sur cet engin curieux, de documents certains; nous n'en connaissons que
la forme générale, qui rappelait celle des grues encore
employées pendant le dernier siècle. Les matériaux
étaient apportés à pied d'œuvre sous le bec
de la grue au moyen de grands binards ou fardiers à deux
roues, ainsi que l'indique la fig. 6. Un long timon servant de levier
permettait, lorsque la pierre avait été bardée sur
le plateau A, de soulever ce plateau en abaissant
l'extrémité B, et de faire rouler l'engin jusqu'au point
où le câble de la grue pouvait saisir la pierre au moyen
d'une louve.
Ces engins sont encore en usage aujourd'hui dans les provinces du
Midi. Il n'y a pas plus de vingt ans que des perfectionnements notables
ont été apportés dans le système et la
fabrication des engins employés pour les constructions;
jusqu'alors les engins dont on se servait au XIIIe
siècle étaient aussi employés soit pour
transporter les matériaux d'un point à un autre, soit
pour les élever verticalement. La chèvre, cette admirable
et simple invention qui remonte à la plus haute
antiquité, est encore en usage aujourd'hui, et il est probable
qu'on s'en servira longtemps.
[modifier] ENGINS DE GUERRE
Il est nécessaire, pour mettre de la clarté dans notre
texte, de diviser ces machines en raison de leur fonction : engins d'attaque, engins d'attaque et de défense, engins de défense seulement.
[modifier] Engins offensifs avant l'artillerie à feu.
Vitruve3
parle de trois machines propres à l'attaque: les catapultes, les
scorpions et les balistes. Les catapultes et les scorpions sont
rangés par lui dans la même catégorie; ces engins
étaient destinés à projeter des dards d'une grande
longueur et d'un poids assez considérable. Naturellement c'est
la dimension du projectile qui donne celle de la machine. Le propulseur
consistait en des ressorts de bois tendus au moyen de cordes et de
treuils. Malheureusement Vitruve, qui relève scrupuleusement les
dimensions relatives de chaque partie de ces machines, oublie de nous
décrire leur structure; de sorte qu'il est difficile de se faire
une idée passablement exacte du système adopté.
Perrault, dans sa traduction du texte latin, nous donne la
représentation d'une catapulte4;
mais nous avouons ne pas être satisfait de son
interprétation. Son propulseur ne pourrait avoir qu'une action
très-faible et ferait plutôt basculer le trait qu'il ne
l'enverrait suivant une ligne droite. Végèce5
parle des balistes, des onagres, des scorpions, des arcs-balistes; mais
ses descriptions sont d'un laconisme tel que l'on ne peut en rien tirer
de concluant; nous savons seulement par lui que la baliste était
tendue au moyen de cordes ou de nerfs, que le scorpion était une
baliste de petite dimension, une sorte d'arbalète, «scorpiones dicebant, quas nunc manubalistas vocant;»
que l'onagre lançait des pierres et que la force des nerfs
devait être calculée en raison du poids des projectiles;
mais il se garde bien de nous faire savoir si ces onagres sont des
machines mises en mouvement par des contre-poids, des cordes tordues ou
des ressorts. Les commentateurs de ces auteurs anciens sont d'autant
plus prolixes que les textes sont plus laconiques ou plus obscurs; mais
ils ne nous donnent pas de solutions pratiques.
Si Végèce semble indiquer que la baliste soit une
grande arbalète fixe propre à lancer des traits, Vitruve
prétend que la baliste est destinée à lancer des
pierres dont le poids varie de deux livres à deux cent cinquante
livres; il ne nous fait pas connaître si cet engin est mu par des
contre-poids ou des ressorts. La baliste donnée par Perrault
enverrait son projectile à dix pas, si même il ne tombait
pas sur l'affût. Ammien Marcellin6
est un peu moins obscur dans les descriptions qu'il nous a
laissées des machines de guerre offensives employées de
son temps, c'est-à-dire au IVe siècle.
D'après cet auteur, la baliste est une sorte de grande
arbalète dont le projectile (le javelot) est lancé par la
force de réaction de plusieurs cordes à boyaux tordues.
Le scorpion, que de son temps on appelait onagre, est
positivement le caable du moyen âge, c'est-à-dire un engin
composé d'un style dont le pied est tortillé entre des
cordes tendues, comme la clef d'une scie, et dont la tête, munie
d'une cuiller, reçoit un boulet que ce style en
décliquant envoie en bombe. Ammien Marcellin désigne
aussi cet engin sous le nom de tormentum, de torquere, tordre.
Nos lecteurs ne nous sauront pas mauvais gré de ne rien
ajouter aux textes aussi diffus que peu concluants des commentateurs de
Vitruve, de Végèce, d'Ammien Marcellin; ils voudront bien
nous permettre de passer à l'étude des engins du moyen
âge sur lesquels nous possédons des données un peu
moins vagues.
Les engins d'attaque, depuis l'invasion des barbares jusqu'à
l'emploi de l'artillerie à feu, sont en grand nombre: les uns
sont mus par des contre-poids comme les trébuchets, les
mangonneaux; d'autres par la tension de cordes, de nerfs, de branches
de ressorts de bois ou d'acier, comme les caables, malvéisines
ou male-voisines, les pierrières; d'autres par leur propre poids
et l'impulsion des bras, comme les moutons, béliers, bossons.
Rien ne nous indique que les Romains, avant le Ve
siècle, aient employé des machines de jet à
contre-poids, tandis qu'ils connaissaient et employaient, ainsi que
nous venons de le dire, les engins à ressorts, les grandes
arbalètes à tour7
à un ou deux pieds, ainsi qu'on peut s'en assurer en examinant
les bas-reliefs de la colonne Trajane. Les machines de jet mues par des
contre-poids sont d'une invention postérieure aux machines
à ressorts, par la raison que les engins à ressorts ne
sont que l'application en grand d'une autre arme de main connue de
toute antiquité, l'arc. Les machines à contre-poids
exigent, dans leur fabrication, un si grand nombre de
précautions, de calculs, et des moyens si puissants, qu'on ne
peut admettre qu'elles aient été connues des barbares qui
envahirent les Gaules. Ceux-ci durent imiter d'abord les machines de
guerre romaines, puis aller demander plus tard à Byzance les
inventions très-perfectionnées des Grecs. Les engins inconnus jusqu'alors
dont parlent les annales de Saint-Bertin, et qui furent dressés
devant les murailles d'Angers occupée en 873 par les Normands,
avaient probablement été importés en France par
ces artistes que Charles le Chauve faisait venir de Byzance. Les
annalistes et les poëtes de ces temps reculés, et
même ceux d'une époque plus récente, sont d'un
laconisme désespérant lorsqu'ils parlent de ces engins,
et ils les désignent indifféremment par des noms pris au
hasard dans l'arsenal de guerre, pour les besoins de la mesure ou de la
rime, de sorte que, jusque vers le temps de Charles V, où les
chroniqueurs deviennent plus précis, plus clairs, il est
certaines machines auxquelles on peut difficilement donner leur nom
propre. Nous allons essayer cependant de trouver l'emploi et la forme
de ces divers engins.
Dans la chanson de Roland, on lit:
«Li reis Marsilie est de guerre vencud,
Vus li avez tuz ses castels toluz,
Od vos caables avez fruiset ses murs,
...»
Or, pour que les murs aient été froissés,
endommagés par les caables, il faut admettre que les caables
lançaient des blocs de pierre. Le caable est donc une
pierrière. «Une grande perière, que l'on claime
chaable, si grosse... 8.» Guibert de Nogent, dans son Histoire des Croisades9,
parle des nombreuses balistes qui furent dressées autour des
murailles de la ville de Césarée par l'armée des
chrétiens. Ces caables ou chaables et ces balistes nous
paraissent être une imitation des engins à ressorts en
usage chez les Romains et perfectionnés par les Byzantins. Il
est certain que ces engins avaient une grande puissance, car le
même auteur rapporte que ces machines vomissaient avec fureur les
plus grosses pierres qui, «non-seulement allaient frapper les
murs extérieurs, mais souvent même atteignaient de leur
choc les palais les plus élevés dans l'intérieur
de la ville.» Ces balistes étaient posées sur des
roues et pouvaient ainsi être changées de place suivant le
besoin; c'était là, d'ailleurs, une tradition romaine,
car sur les bas-reliefs de la colonne Trajane on voit quelques-uns de
ces engins posés sur des chariots traînés par des
chevaux. Beaucoup d'auteurs ont essayé, en s'appuyant sur les
représentations peintes ou sculptées du moyen âge,
de rendre compte de la construction de ces machines de jet; mais ces
interprétations figurées nous paraissent être en
dehors de la pratique et ressembler à des jouets d'enfants assez
naïvement conçus. Cependant leur effet, bien qu'il ne
pût être comparé à celui produit par
l'artillerie à feu, occasionnait de tels désordres dans
les travaux de fortification, qu'il faut bien croire à leur
puissance et tâcher d'en donner une idée exacte. C'est ce
à quoi nous nous attachons dans les figurés qui vont
suivre, et qui, tout en respectant les données
générales que nous fournissent les vignettes des
manuscrits et les bas-reliefs, sont étudiés comme s'il
fallait en venir à l'exécution. Bien entendu, dans ces
figurés, nous n'avons admis que les procédés
mécaniques connus des ingénieurs du moyen âge.
Voici donc d'abord un de ces engins, baliste, caable ou
pierrière, mu par des ressorts et des cordes bridées,
propre à lancer des pierres (7). La pièce principale est
la verge A, dont l'extrémité inférieure passe dans
un faisceau de cordes tordues au moyen de clefs B et de roues à
dents C, arrêtées par des cliquets. Les cordes sont
passées dans deux anneaux tenant à la tige à
laquelle la roue à dents vient s'adapter, ainsi que l'indique le
détail D. Ces cordes ou nerfs tordus à volonté
à la partie inférieure de la verge avaient une grande
force de rappel10.
Mais pour augmenter encore la rapidité de mouvement que devait
prendre la verge, des ressorts en bois et nerfs entourés de
cordes, formant deux branches d'arcs E attachées à la
traverse-obstacle, forçaient la verge à venir frapper
violemment cette traverse F, lorsqu'au moyen du treuil G on avait
amené cette verge à la position horizontale. Lorsque la
verge A était abaissée autant que possible, un homme,
tirant sur la cordelette H, faisait échapper la branche de fer I
(voy.le détail K), et la verge ramenée rapidement
à la position verticale, arrêtée par la
traverse-obstacle F, envoyait au loin le projectile placé dans
la cuiller L. On réglait le tir en ajoutant ou en supprimant des
fourrures en dedans de la traverse F, de manière à
avancer ou à reculer l'obstacle, ou en attachant des coussins de
cuir rembourrés de chiffons à la paroi antérieure
de l'arbre de la verge. Plus l'obstacle était avancé,
plus le tir était élevé; plus il était
reculé, plus le tir était rasant. Le projectile
obéissait à la force centrifuge déterminée
par le mouvement de rotation de la cuiller et à la force
d'impulsion horizontale déterminée par l'arrêt de
la traverse F. La partie inférieure de la verge
présentait la section M, afin d'empêcher la
déviation de l'arbre qui, d'ailleurs, était maintenu dans
son plan par les deux tirages des branches du ressort E. Les crochets O
servaient à fixer le chariot en place, au moyen de cordes
liées à des piquets enfoncés en terre, et à
attacher les traits et palonniers nécessaires lorsqu'il
était besoin de le traîner. Quatre hommes pouvaient
abaisser la verge en agissant sur le treuil G. Pour qu'un engin pareil
ne fût pas détraqué promptement par la secousse
terrible que devait occasionner la verge en frappant sur la
traverse-obstacle, il fallait nécessairement que cette traverse
fût maintenue par des contre-fiches en charpente et par des
brides en fer, ainsi que l'indique notre fig. 7. Un profil
géométral (8) fait voir la verge abaissée au moyen
du treuil et la verge frappant la traverse-obstacle, ainsi que le
départ du projectile de la cuiller, les ressorts tendus lorsque
la verge est abaissée, et détendus lorsqu'elle est
revenue à sa position normale.
Des machines analogues à celle-ci servaient aussi à
lancer des traits; mais nous y reviendrons bientôt en parlant des
grandes arbalètes à tour. Nous allons continuer la revue
des engins propres à jeter des pierres ou autres projectiles en
bombe.
Villard de Honnecourt11
nous donne le plan d'un de ces grands trébuchets à
contre-poids si fort employés pendant les guerres des XIIe et XIIIe siècles. Quoique l'élévation de cet engin manque dans le manuscrit de notre architecte picard du XIIIe
siècle, cependant la figure qu'il présente et
l'explication qu'il y joint jettent une vive lumière sur ces
sortes de machines. Villard écrit au bas de son plan la
légende suivante12:
«Se vus voles faire le fort engieng con apiele trebucet prendes
ci gard. Ves ent ci les soles si com il siet sor tierre. Ves la devant
les .ij. windas13
et le corde ploie a coi ou ravale la verge. Veir le poes en cele autre
pagene (c'est cette seconde page qui manque). Il y a grant fais al
ravaler, car li contrepois est mult pesans. Car il i a une huge plainne
de tierre. Ki .ij. grans toizes a de lonc et .viiij. pies de le, et
.xij. pies de profont. El al descocier de le fleke14
penses. Et si vus en donez gard, car ille doit estre atenue a cel
estancon la devant.» Le plan donné par Villard
présente deux sablières parallèles espacées
l'une de l'autre de huit pieds, et ayant chacune trente-quatre pieds de
long. À quatorze pieds de l'extrémité
antérieure des sablières est une traverse qui, à
l'échelle, paraît avoir vingt-cinq pieds de long; puis
quatre grands goussets, une croix de Saint-André horizontale
entre les deux sablières longitudinales; près de
l'extrémité postérieure, les deux treuils
accompagnés de deux grands ressorts horizontaux en bois. C'est
là un engin énorme, et Villard a raison de recommander de
prendre garde à soi au moment où la verge est
décochée. Présentons de suite une
élévation perspective de cette machine, afin que nos
lecteurs puissent en prendre une idée générale.
Villard ne nous donne que le plan des sablières sur le sol, mais
nombre de vignettes de manuscrits nous permettent de compléter
la figure. Un des points importants de la description de Villard, c'est
le cube du contre-poids. Ces huches ne sont pas des
parallélipipèdes, mais des portions de cylindres dans la
plupart des anciennes représentations: or, en donnant à
cette huche la forme indiquée dans notre fig. 9 et les
dimensions exprimées dans le texte de Villard, nous trouvons un
cube d'environ 20 mètres; en mettant le mètre de terre
à 1,200 kil., nous obtenons 26,000 kil. «Il y a grand faix
à ravaler.» Pour faire changer de place un pareil poids,
il fallait un levier d'une grande longueur: la verge était ce
levier; elle avait de quatre toises à six toises de long (de
huit à douze mètres), se composait de deux pièces
de bois fortement réunies par des frettes en fer et des cordes,
et recevant entre elles deux un axe en fer façonné ainsi
que l'indique le détail A. Les tourillons de cet axe entraient
dans les deux pièces verticales B, renforcées,
ferrées à leur extrémité et maintenues dans
leur plan par des contre-fiches. En cas de rupture du tourillon, un
repos C recevait le renfort C', afin d'éviter la chute de la
verge et tous les dégâts que cette chute pouvait causer.
Voyons comme on manœuvrait cet engin, dont le profil
géométral est donné (1O). Lorsque la verge
était laissée libre, sollicitée par le
contre-poids C, elle prenait la position verticale AB. C'était
pour lui faire abandonner cette position verticale qu'il fallait un
plus grand effort de tirage, à cause de l'aiguité de
l'angle formé par la corde de tirage et la verge; alors on avait
recours aux deux grands ressorts de bois tracés sur le plan de
Villard et reproduits sur notre vue perspective (fig. 9). Les cordes
attachées aux extrémités de ces deux ressorts
venaient, en passant dans la gorge de deux poulies de renvoi,
s'attacher à des chevilles plantées dans le second treuil
D (fig. 1O); en manœuvrant ce treuil à rebours, on bandait
les deux cordes autant que pouvaient le permettre les deux ressorts.
Préalablement, la boucle E, avec ses poulies jumelles F, dans
lesquelles passait la corde de tirage, avait été
fixée à l'anneau G au moyen de la cheville H (voy. le
détail X). La poulie I roulait sur un cordage peu tendu K,L,
afin de rendre le tirage des treuils aussi direct que possible. Au
moment donc où il s'agissait d'abaisser la verge, tout
étant ainsi préparé, un servant étant
monté attacher la corde double à l'anneau de la poulie de
tirage, on décliquait le treuil tourné à rebours,
les ressorts tendaient à reprendre leur position, ils faisaient
faire un ou deux tours au treuil D dans le sens voulu pour l'abattage
et aidaient ainsi aux hommes qui commençaient à agir sur
les deux treuils, ce qui demandait d'autant moins de force que la verge
s'éloignait de la verticale. Alors on détachait les
boucles des cordes des ressorts
et on continuait l'abattage sur les deux treuils en a b et a' b'.
Huit hommes (deux par levier pour un engin de la dimension de celui
représenté fig. 10), dès l'instant que la verge
était sortie de la ligne verticale au moyen des ressorts,
pouvaient amener celle-ci suivant la position A'B'. Le chargeur prenait
la poche en cuir et cordes M, la rangeait dans la rigole horizontale en
M', plaçait dedans un projectile; puis, d'un coup de maillet, le
décliqueur faisait sauter la cheville H. La verge,
n'étant plus retenue, reprenait la position verticale par un
mouvement rapide et envoyait le projectile au loin. C'est ici où
l'on ne se rend pas, faute de l'expérience acquise par la
pratique, un compte exact de l'effet des forces combinées, de la
révolution suivie par le projectile et du moment où il
doit quitter sa poche. Quelques commentateurs paraissent avoir
considéré la poche du projectile comme une
véritable fronde se composant de deux attaches, dont une fixe et
l'autre mobile, de manière que, par le mouvement de rotation
imprimé au projectile, l'une des deux attaches de la fronde
quittait son point d'attache provisoire, et le projectile ainsi
abandonné à lui-même décrivait dans l'espace
une parabole plus ou moins allongée.
D'abord, bien des causes pouvaient modifier le décrochement
de l'une des cordes de la fronde: le poids du projectile, son tirage
plus ou moins prononcé sur l'une des deux cordes, un
léger obstacle, un frottement. Il pouvait se faire ou que le
décrochement eût lieu trop tôt, alors le projectile
était lancé verticalement et retombait sur la tête
des tendeurs; ou qu'il ne se décrochât pas du tout, et
qu'alors, rabattu avec violence sur la verge, il ne la brisât. En
consultant les bas-reliefs et les vignettes des manuscrits, nous ne
voyons pas figurés ces ceux brides de fronde et l'attache
provisoire de l'une d'elles; au contraire, les brides de la fronde
paraissent ne faire qu'un seul faisceau de cordes ou de
lanières, avec une poche à l'extrémité,
comme l'indique nos figures. De plus, nous voyons souvent, dans les
vignettes des manuscrits, une seconde attache placée en
contre-bas de l'attache de la fronde et qui paraît devoir brider
celle-ci, ainsi que le fait voir même la vignette (11) reproduite
dans les éditions française et anglaise de Villard de
Honnecourt. Ici le tendeur tient à la main cette bride
secondaire et paraît l'attacher à la queue de la fronde.
C'est cette bride, ce sous-tendeur, que dans nos deux fig. 9 et 10 nous
avons tracé en P, le supposant double et pouvant être
attaché à différents points de la queue de la
fronde; on va voir pourquoi.
Soit (12) le mouvement de la verge, lorsque après avoir
été abaissée elle reprend brusquement la position
verticale par l'effet du contre-poids. Le projectile devra
décrire la courbe ABC. Or il arrive un moment où la
fronde sera normale à l'arc de cercle décrit par la
verge, c'est-à-dire où cette fronde sera exactement dans
le prolongement de la verge qui est le rayon de cet arc de cercle.
Alors le projectile, mu par une force centrifuge considérable,
tendra à s'échapper de sa poche. Il est clair que la
fronde sera plus rapidement amenée dans la ligne de prolongement
de la verge suivant que cette fronde sera plus courte et que le poids
du projectile sera plus considérable. Si la fronde arrive dans
le prolongement de la ligne de la verge lorsque celle-ci est au point D
de l'arc de cercle, le projectile ne sera pas lancé du
côté des ennemis, mais au contraire sur ceux qui sont
placés derrière l'engin. Il y avait donc un premier
calcul à faire pour donner à la fronde une longueur
voulue, afin qu'ayant à lancer un poids de... elle arrivât
dans le prolongement de la ligne de la verge lorsque celle-ci
était près d'atteindre son apogée. Mais il fallait
alors déterminer par une secousse brusque le départ du
projectile, qui autrement aurait quitté le rayon en
s'éloignant de l'engin presque verticalement. C'était
pour déterminer cette secousse qu'était fait le
sous-tendeur P. Si ce sous-tendeur P était attaché en P',
par exemple, de manière à former avec la verge et la
queue de la fronde le triangle P'OR, la queue OP' ne pouvait plus
sortir de l'angle P'OR, ni se mouvoir sur le point de rotation O. Mais
le projectile C continuant sa course forçait la poche de la
fronde à obéir à ce mouvement d'impulsion jusqu'au
moment où cette poche, se renversant tout à fait, le
projectile abandonné à lui-même était
appelé par la force centrifuge et la force d'impulsion
donnée par l'arrêt brusque du sous-tendeur à
décrire une parabole C'E.
Si, comme l'indique le tracé S, le sous-tendeur P était fixé en P, c'est-à-dire plus près de l'attache de la queue de la fronde, et formait un triangle POR dont l'angle O' était moins obtus que celui de l'exemple précédent,
la secousse se faisait sentir plus tôt, la portion de la fronde
laissée libre décrivait une portion de cercle CC, ou plutôt une courbe CC', par suite du mouvement principal de la verge; le projectile C',
abandonné à lui-même sous le double mouvement de la
force centrifuge principale et de la force centrifuge secondaire
occasionnée par l'arrêt P, était lancé suivant une ligne parabolique C''E,
se rapprochant plus de la ligne horizontale que dans l'exemple
précédent. En un mot, plus le sous-tendeur P était
raidi et fixé près de l'attache de la fronde, plus le
projectile était lancé horizontalement; plus, au
contraire, ce sous-tendeur était lâche et attaché
près de la poche de la fronde, plus le projectile était
lancé verticalement. Ces sous-tendeurs étaient donc un
moyen nécessaire pour régler le tir et assurer le
départ du projectile.
S'il fallait régler le tir, il fallait aussi éviter
les effets destructeurs du contre-poids qui, arrivé à son
point extrême de chute, devait occasionner une secousse terrible
à la verge, ou briser tous les assemblages des contre-fiches.
À cet effet, non-seulement le mouvement du contre-poids
était double, c'est-à-dire que ce contre-poids
était attaché à deux bielles avec deux tourillons,
mais encore, souvent aux bielles mêmes, étaient
fixés des poids en bascule, ainsi que le font voir nos figures
précédentes. Voici quel était l'effet de ces poids
T. Lorsque la verge se relevait brusquement sous l'influence de la
huche chargée de terre ou de pierres, les poids T, en descendant
rapidement, exerçaient une influence sur les bielles au moment
où la huche arrivait au point extrême de sa chute et
où elle était retenue par la résistance
opposée par la verge. Les poids n'ayant pas à subir
directement cette résistance, continuant leur mouvement de
chute, faisaient incliner les bielles suivant une ligne gh et
détruisaient ainsi en partie le mouvement de secousse
imprimé par la tension brusque de ces bielles. Les poids T
décomposaient, jusqu'à un certain point, le tirage
vertical produit par la huche, et neutralisaient la secousse qui
eût fait rompre tous les tourillons, sans altérer en rien
le mouvement rapide de la verge, en substituant un frottement sur les
tourillons à un choc produit par une brusque tension.
Ces engins à contre-poids furent en usage jusqu'au moment
où l'artillerie à feu vint remplacer toutes les machines
de jet du moyen âge. Le savant bibliophile M. Pichon
possède un compte (attachement) de ce qui a été
payé pour le transport d'un de ces engins en 1378, lequel avait
servi au siège de Cherbourg. Voici ce curieux document, que son
possesseur a bien voulu nous communiquer: «La monstre Thomin le
bourgois de Pontorson gouvernour de l'engin de la dite ville, du
maistre charpentier, de V autres charpentiers, de X maçons et
cancours, de XL tendeurs et XXXI charrêt à compter le
cariot qui porte la verge d'iceluy engin; pour trois charreltiers qui
sont ordennés servir celui engin au siége de Cherbourt,
venu à Carentan et nous Endouin Channeron, dotteur en la
seigneurie, bailly de Costentin et Jehan des Îles, bailly illec
pour le roy notre sire es terres qui furent au roy de Navarre, comis et
députez en ceste partie, de par nos seigneurs les
généraulx commis, du roy notre sire pour le fait dudit
siége; le XV jour de novembre l'an MCCCLXXVIII.»
«Et premièrement:»
«Le dit Thomin le maistre gonduom dudit engin, X jours. . . . . .XΓ
vault pour X jours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DΓ
Some ci dessus.»
«Michel Rouffe, maistre charpentier dudit engin, X jours. . . . .VΓ
vault pour X jours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CΓ
Etc.»
Suit le compte des charpentiers, maçons, tendeurs, charrettes
et chevaux. Cet attachement fait connaître l'importance de ces
machines qui exigeaient un personnel aussi nombreux pour les monter et
les faire agir. Le chiffre de quarante tendeurs indique assez la
puissance de ces engins: car, en supposant qu'ils fussent
divisés en deux brigades (leur service étant
très-fatigant, puisqu'ils étaient chargés de la
manœuvre des treuils), il fallait donc vingt tendeurs pour
abaisser la verge du trébuchet. Les maçons étaient
probablement employés à dresser les aires de niveau sur
lesquelles on asseyait l'engin15. Pierre de Vaux-Cernay, dans son Histoire des Albigeois,
parle de nombreux mangonneaux dressés par l'armée des
croisés devant le château des Termes, et qui jetaient
contre cette place des pierres énormes, si bien que ces
projectiles firent plusieurs brèches. Au siége du
château de Minerve (en Minervois), dit ce même auteur,
«on éleva du côté des Gascons une machine de
celles qu'on nomme mangonneaux, dans laquelle ils travaillaient nuit et
jour avec beaucoup d'ardeur. Pareillement, au midi et au nord, on
dressa deux machines, savoir une de chaque côté; enfin, du
côté du comte, c'est-à-dire à l'orient,
était une excellente et immense pierrière, qui chaque
jour coûtait vingt et une livres pour le salaire des ouvriers qui
y étaient employés.» Au siége de
Castelnaudary, entrepris contre Simon de Montfort, le comte de Toulouse
fit «préparer un engin de grandeur monstrueuse pour ruiner
les murailles du château, lequel lançait des pierres
énormes, et renversait tout ce qu'il atteignait... Un jour le
comte (Simon de Montfort) s'avançait pour détruire la
susdite machine; et comme les ennemis l'avaient entourée de
fossés et de barrières tellement que nos gens ne
pouvaient y arriver...» En effet, on avait toujours le soin
d'entourer ces engins de barrières, de claies, tant pour
empêcher les ennemis de les détruire que pour
préserver les hommes qui les servaient. Au siége de
Toulouse, Pierre de Vaux-Cernay raconte que, dans le combat où
Simon de Montfort fut tué, «le comte et le peu de monde
qui était avec lui se retirant à cause d'une grêle
de pierres et de l'insupportable nuée de flèches qui les
accablaient, s'arrêtèrent devant les machines,
derrière des claies, pour se mettre à l'abri des unes et
des autres; car les ennemis lançaient sur les nôtres une
énorme quantité de cailloux au moyen de deux
trébuchets, un mangonneau et plusieurs engins...» C'est
alors que Simon de Montfort fut atteint d'une pierre lancée par
une pierrière que servaient des femmes sur la place de
Saint-Sernin, c'est-à-dire à cent toises au moins de
l'endroit où se livrait le combat. Quelquefois les anciens
auteurs semblent distinguer, comme dans ce passage, les
trébuchets des mangonneaux. Les mangonneaux sont certainement
des machines à contre-poids comme les trébuchets; mais
les mangonneaux avaient un poids fixe placé à la queue de
la verge au lieu d'un poids mobile, ce qui leur donnait une
qualité particulière.
Villard de Honnecourt appelle l'engin à contre-poids suspendu par des bielles, à contre-poids en forme de huche, trébuchet;
d'où l'on doit conclure que si le mangonneau est aussi un engin
à contre-poids, ce ne peut être que l'engin-balancier, tel
que celui figuré dans le bas-relief de Saint-Nazaire de
Carcassonne16 et dans beaucoup de vignettes de manuscrits17.
Nous avons vu que la fronde du trébuchet a ses deux branches
attachées à la tête de la verge, et que le
projectile quitte la poche de cette fronde par l'effet d'une secousse
produite par des sous-tendeurs. Dans les représentations des
engins à verge et à balancier, l'un des bras de la fronde
est fixé à l'extrémité de la verge et
l'autre est simplement passé dans un style disposé de
telle façon que, quand la verge arrive à son
apogée, ce bras de fronde quitte son style et le projectile est
lancé comme la balle d'une fronde à main. Cet engin,
ainsi que nous le disions tout à l'heure, possède
d'autres qualités que le trébuchet. Le trébuchet,
par son mouvement brusque, saccadé, était bon pour lancer
les projectiles par-dessus de hautes murailles, sur des combles, comme
nos mortiers lancent les bombes; mais il ne pouvait faire
décrire au projectile une parabole très-allongée
se rapprochant de la ligne horizontale. Le tir du mangonneau pouvait se
régler beaucoup mieux que celui du trébuchet, parce qu'il
décrivait un plus grand arc de cercle et qu'il était
possible d'accélérer son mouvement.
Essayons donc d'expliquer cet engin.
D'abord (voy. fig. 13) la verge, au lieu de passer dans l'axe du
tourillon, se trouvait fixée en dehors, ainsi que l'indique le
tracé en A. À son extrémité
inférieure, qui s'élargissait beaucoup (nous allons voir
comment et pourquoi), étaient attachés des poids, lingots
de fer ou de plomb, ou des pierres, maintenus par une armature et un
coffre de planches B. Dans son état normal, la verge, au lieu
d'être verticale comme dans le trébuchet, devait
nécessairement s'incliner du côté de l'ennemi,
c'est-à-dire sur la face de l'engin18,
à cause de la position du contre-poids et celle de l'arbre. Pour
abaisser la verge, on se servait de deux roues C, fixées
à un treuil et correspondant à deux poulies de renvoi D.
Il est clair que devant l'ennemi, il n'était pas possible de
faire monter un servant au sommet de la verge pour y fixer la corde
double de tirage avec sa poulie et son crochet, d'abord parce que cette
corde et cette poulie devaient être d'un poids assez
considérable, puis parce qu'un homme qui se serait ainsi
exposé aux regards ennemis eût servi de point de mire
à tous les archers et arbalétriers. Nous avons vu tout
à l'heure que ces engins étaient entourés de
barrières et de claies destinées à garantir les
servants qui restaient sur le sol. Au moyen d'un petit treuil E,
attaché aux parois de la caisse du contre-poids et mu par deux
manivelles, on amenait, à l'aide de la corde double F passant
par deux fortes poulies G, la poulie H et son crochet auquel
préalablement on avait accroché l'autre poulie K. La
verge abaissée suivant l'inclinaison LM, on faisait sauter le
crochet de la poulie K, et la verge décrivait l'arc de cercle
MN. Les servants précipitaient ce mouvement en tirant sur
plusieurs cordes attachées en O, suivant la direction OR. Si,
lors du décliquement de la verge, les servants tiraient vivement
et bien ensemble sur ces cordes, ils faisaient décrire à
l'extrémité supérieure de la verge un arc de
cercle beaucoup plus grand que celui donné par la seule action
du contre-poids, et ils augmentaient ainsi la force d'impulsion du
projectile S au moment de son départ. Pour rattacher la poulie K
à la poulie H, on tirait celle-ci au moyen d'un fil P en
déroulant le treuil E, on descendait cette poulie H aussi bas
qu'il était nécessaire, on y rattachait la poulie K, on
appuyait de nouveau sur le treuil E. Cette manœuvre était
assez rapide pour qu'il fût possible d'envoyer douze projectiles
en une heure.
Pour faciliter l'abaissement de la verge, lorsque les tendeurs
agissaient sur les deux grandes roues C, les hommes
préposés à la manœuvre des cordes du
balancier B tiraient sur ces cordes attachées en O, suivant la
ligne OV. Lorsque la verge était abaissée, les servants
chargés de l'attache de la fronde étendaient les deux
brides de cette fronde dans la rigole T. L'une de ces brides restait
fixée à l'anneau X, l'autre était sortie
d'elle-même du style U; les servants avaient le soin de replacer
l'anneau de cette seconde bride dans le style et, bien entendu,
laissaient passer ces deux brides par-dessus la corde double de tirage
de la verge, ainsi que l'indique la coupe Z, présentant en a l'extrémité de la verge abaissée avec sa poulie H en h, sa poulie K en k, les deux poulies D en d, les deux brides de la fronde en gg. Lorsque le décliqueur agissait sur la petite bascule e du crochet, la poulie K tombait entre les deux sablières, la verge se relevait et les deux brides gg
tiraient le projectile S. On observera ici que le projectile S
étant posé dans la poche de la fronde, les deux brides de
cette fronde devant être égales en longueur, l'une, celle
attachée à l'anneau X, est lâche, tandis que celle
fixée au style est presque tendue. L'utilité de cette
manœuvre va tout à l'heure être
démontrée. On voudra bien encore examiner la position du
contre-poids lorsque la verge est abaissée; cette position est
telle que la verge devait se trouver en équilibre; que, par
conséquent, l'effort des tendeurs, pour l'amener à son
déclin, devait être à peu près nul, ce qui
permettait de tendre la corde sur la poulie k, ainsi que
l'indique la coupe Z; que cet équilibre, obtenu par les
pesanteurs principales reportées sur le tourillon A, rendait
efficace le tirage des hommes préposés au balancier,
puisqu'au moment du décliquement il devait y avoir une sorte
d'indécision dans le mouvement de la verge; que ce tirage
ajoutait alors un puissant appoint au poids du balancier, ce qui
était nécessaire pour que la fronde fonctionnât
convenablement.
La fig. 14 représente le mangonneau du côté de
sa face antérieure, au moment où la verge est
abaissée. Les six hommes agissant sur les deux grands treuils
sont restés dans les roues afin de dérouler le
câble doublé lorsque la verge aura lancé le
projectile qui est placé dans la poche de la fronde. Seize
hommes s'apprêtent à tirer sur les quatre cordes
attachées à la partie inférieure du contre-poids.
Le décliqueur est à son poste, en A, prêt à
faire sauter le crochet qui retient l'extrémité de la
verge abaissée. Le maître de l'engin est en B; il va
donner le signal qui doit faire agir simultanément le
décliqueur et les tireurs; à sa voix, la verge
n'étant plus retenue, sollicitée par les seize hommes
placés en avant, va se relever brusquement, entraînant sa
fronde, qui, en sifflant, décrira une grande courbe et lancera
son projectile.
Examinons maintenant comment la fronde devait être
attachée pour qu'une de ses branches pût quitter en temps
opportun le style de l'engin, afin de laisser au projectile la
liberté de s'échapper de la poche.
Voici (15) l'extrémité de la verge; on voit, en A,
l'attache fixe qui se compose d'un long étrier tournant sur un
boulon B; puis, en C, le style en fer, élargi à sa base,
et en D la boucle qui n'entre dans ce style que jusqu'à un
certain point qu'elle ne peut dépasser à cause de cet
élargissement. Lorsque l'étrier est sollicité par
l'une des brides de la fronde (voy.le profil G), il faut que son anneau
E tombe sur la circonférence décrite par l'anneau F de la
boucle, circonférence dont, bien entendu, la verge est le rayon;
il faut aussi que l'étrier ne puisse dépasser la ligne IE
et soit arrêté en K par la largeur du bout de la verge.
Tant que la bride de la fronde attachée à l'anneau E de
l'étrier n'a pas, par suite du mouvement imprimé,
dépassé la ligne EE'; prolongement de la ligne IE,
l'autre bride de la fronde tire sur la boucle F obliquement, de telle
façon que cette boucle ne peut quitter le style C.
Ceci compris, la figure 16 indique le mouvement de rotation de la
verge. La bride mobile de la fronde ne quittera le style que lorsque le
projectile aura dépassé le rayon du cercle décrit
par la verge, qu'au moment où les brides de la fronde formeront
avec la verge un angle, ainsi qu'il est tracé dans la position
A. Alors, l'une des brides de la fronde continuera à tirer sur
l'étrier, tandis que l'autre se relâchera, et la force
centrifuge imprimée au projectile fera échapper la boucle
du style, comme nous le voyons en M. Le projectile libre décrira
sa parabole. Si le mouvement de rotation de la verge était
égal ou progressivement
accéléré, il arriverait un moment où le
projectile se trouverait dans le prolongement de la ligne de la verge
(rayon) pour ne plus quitter cette ligne qu'au moment où la
verge s'arrêterait. Mais il n'en est pas ainsi, grâce
à la disposition du tourillon hors de la ligne de la verge, de
la place du contre-poids hors d'axe et du tirage des hommes pour
hâter le mouvement de rotation au moment du décliquement;
une force d'impulsion très-violente est d'abord donnée
à la verge et par suite au projectile; celui-ci, sous l'empire
de cette force première, décrit sa courbe plus rapidement
que la verge ne décrit son arc-de-cercle, d'autant que le
mouvement de celle-ci se ralentit à mesure qu'elle approche de
son apogée; dès lors, les brides de la fronde doivent
faire un angle avec la verge, ainsi qu'on le voit en M.
C'étaient donc les hommes placés à la base du
contre-poids qui réglaient le tir, en appuyant plus ou moins sur
les cordes de tirage. S'ils appuyaient fortement, la verge
décrivait son arc de cercle avec plus de rapidité, la
force centrifuge du projectile était plus grande; il
dépassait plus tôt la ligne de prolongement de la verge;
le bras mobile de la fronde se détachait plus tôt et le
projectile s'élevait plus haut, mais parcourait un moins grand
espace de terrain. Si, au contraire, les hommes du contre-poids
appuyaient mollement sur les cordes de tirage ou n'appuyaient pas du
tout, le projectile était plus lent à dépasser la
ligne de prolongement de la verge; le bras mobile de la fronde se
détachait plus tard, et le projectile, n'abandonnant sa poche
que lorsque celle-ci avait dépassé la verticale,
s'élevait moins haut, mais parcourait un espace de terrain plus
étendu. Ainsi le mérite d'un bon maître engingneur
était, d'abord, de donner aux brides de la fronde la longueur
voulue en raison du poids du projectile, puis de régler
l'attache de ces deux brides, puis enfin de commander d'appuyer plus ou
moins sur les cordes de tirage, suivant qu'il voulait envoyer son
projectile plus haut ou plus loin.
Il y avait donc une différence notable entre le
trébuchet et le mangonneau. Le trébuchet était un
engin beaucoup moins docile que le mangonneau, mais il exigeait moins
de pratique, puisque pour en régler le tir il suffisait d'un
homme qui sût attacher les brides de sous-tension de la fronde.
Le mangonneau devait être dirigé par un engingneur habile
et servi par des hommes au fait de la manœuvre, sinon il
était dangereux pour ceux qui l'employaient. Il est, en effet,
quelquefois question de mangonneaux qui blessent et tuent leurs
servants: une fausse manœuvre, un tirage exercé mal
à propos sur les cordes du contre-poids, et alors que celui-ci
avait déjà fait une partie de sa révolution,
pouvait faire décrocher la bride de la fronde trop tard et
projeter la pierre sur les servants placés à la partie
antérieure de l'engin.
Il serait superflu d'insister davantage sur le mécanisme de
ces engins à contre-poids; nous n'avons prétendu ici que
donner à cette étude un tour plus pratique que par le
passé. Il est clair que pour connaître exactement les
effets de ces formidables machines de guerre, il faudrait les faire
fabriquer en grand et les mettre à l'épreuve, ce qui
aujourd'hui devient inutile en face des canons rayés; nous avons
pensé qu'il était bon de faire connaître seulement
que nos pères apportaient dans l'art de tuer les hommes la
subtilité et l'attention qu'ils mettaient à leur
bâtir des palais ou des églises. Ces batteries d'engins
à contre-poids, qui nuit et jour envoyaient sans trève
des projectiles dans les camps ou les villes ennemies, causant de si
terribles dommages qu'il fallait venir à composition,
n'étaient donc pas des joujoux comme ceux que l'on nous montre
habituellement dans les ouvrages sur l'art militaire du moyen
âge. Les projectiles étaient de diverses sortes: boulets
de pierre, paquets de cailloux, amas de charognes, matières
incendiaires, etc19.
Les Orientaux, qui paraissent être les premiers inventeurs de
ces engins à contre-poids, s'en servaient avec avantage
déjà dès le XIe siècle. Ils employaient aussi les pierrières, chaables, pierrières turques,
au moyen desquelles ils jetaient sur les ouvrages ennemis non-seulement
des pierres, mais aussi des barils pleins de matières
inflammables (feu grégeois) que l'eau ne pouvait
éteindre, et qui s'attachaient en brûlant sur les
charpentes des hourds ou des machines.
Joinville nous a laissé une description saisissante des
terribles effets de ces engins. «Le roy ot conseil, dit-il, quand
il s'agit de passer un des bras du Nil devant les Sarrasins, que il
feroit faire une chauciée par mi la rivière pour passer
vers les Sarrasins. Pour garder ceux qui ouvroient (travaillaient)
à la chauciée, et fit faire le roy deux beffrois que l'en
appele chas-chastiau (nous parlerons tout à l'heure de ces
sortes d'engins); car il avoit deux chastiaus devant les chas et deux
massons (palissades) derrière les chastiaus, pour couvrir ceulz
qui guieteroient (qui feraient le guet), pour (contre) les copz des
engins aux Sarrazins, lesquiex avoient seize engins touz drois (sur une
même ligne, en batterie). Quant nous venimes là, le roy
fist faire dix huit engins, dont Jocelin de Cornaut estoit mestre
engingneur (un maître engingneur commandait donc la
manœuvre de plusieurs engins). Nos engins getoient au leur, et
les leurs aus nostres; mès onques n'oy dire que les nostres
feissent biaucop... Un soir avint, là où nous guietions
les chas-chastiaus de nuit, que il nous avièrent un engin que
l'en appèle perrière, ce que il n'avoient encore fait, et
mistrent le feu gregoiz en la fonde de l'engin (cuiller de l'engin)...
Le premier cop que il jetèrent vint entre nos deux chastelz, et
chaï en la place devant nous que l'ost avoit fait pour boucher le
fleuve. Nos esteingneurs (on avait donc des hommes spécialement
chargés d'éteindre les incendies allumés par les
ennemis) furent appareillés pour estaindre le feu; et pour ce
que les Sarrazins ne pooient trère à eulz (tirer sur ces
éteigneurs), pour les deux eles des paveillons que le roy y
avoit fait faire (à cause des ouvrages palissadés qui
réunissaient les chas-chatelz), il traioient tout droit vers les
nues, si que li pylet (les dards) leur cheoient tout droit vers eulz
(tombaient verticalement sur eux). La manière du feu gregois
estoit tele, que il venoit bien devant aussi gros comme un tonnel de
verjus (comme un baril), et la queue du feu qui partoit de li (la
fusée), estoit bien aussi grant comme un grant glaive; il
faisoit tele noise au venir (tel dommage en tombant), que il sembloit
que ce feust la foudre du ciel; il sembloit un dragon qui volast par
l'air, tant getoit grant clarté, que l'on véoit parmi
l'ost comme se il feust jour, pour la grant foison du feu qui jetoit la
grant clarté...»
Ces barils remplis de matières inflammables paraissent
être lancés par des pierrières ou caables comme
celui représenté fig. 7 et 8; ils étaient munis
d'une fusée et contenaient une matière composée de
soufre, d'huile de naphte, de camphre, de bitume ou de résine,
de poussière de charbon, de salpêtre et peut-être
d'antimoine. À cette époque, au milieu du XIIIe
siècle, il semble, d'après Joinville, que nos machines de
jet fussent inférieures à celles des Turcs, puisque notre
auteur, toujours sincère, a le soin de dire que nos engins ne
produisaient pas grand effet. Ce n'est guère, en effet,
qu'à la fin du XIIIe siècle que les engins
paraissent être arrivés, en France, à une grande
perfection. On s'en servait beaucoup dans les guerres du XIVe siècle et même après l'invention de l'artillerie à feu.
Les trébuchets, les mangonneaux étaient placés,
par les assiégés, derrière les courtines, sur le
sol, et envoyaient leurs projectiles sur les ennemis en passant
par-dessus la tête des arbalétriers posés sur les
chemins de ronde. Mais, outre les pierrières ou caables, que
l'on mettait en batterie au niveau des chemins de ronde sur des
plates-formes en bois élargissant ces chemins de ronde (ainsi
que nous l'avons fait voir dans l'article Architecture Militaire,
fig. 32), les armées du moyen âge possédaient
encore l'arbalète à tour, qui était un engin
terrible, avec lequel on lançait des dards d'une grande
longueur, des barres de fer rougies au feu, des traits garnis
d'étoupe et de feu grégeois20
en forme de fusées. Ces arbalètes à tour avaient
cet avantage qu'elles pouvaient être pointées comme nos
pièces d'artillerie, ce que l'on ne pouvait faire avec les
mangonneaux ou les trébuchets: car, pour ces derniers engins,
s'il était possible de régler le tir, ce ne pouvait
être toujours que dans un même plan; si on voulait faire
dévier le projectile à droite ou à gauche, il
fallait manœuvrer l'engin entier, ce qui était long. Aussi
les mangonneaux et les trébuchets n'étaient
employés que dans les sièges, soit par les
assiégeants pour envoyer des projectiles sur un point des
défenses de la ville, soit par les assiégés pour
battre des travaux d'approche ou des quartiers ennemis. Les
arbalètes à tour tiraient sur des groupes de
travailleurs, sur des engins, sur des colonnes serrées, et elles
produisaient l'effet de nos pièces de campagne, à la
portée près; car leurs projectiles tuaient des files
entières de soldats, rompaient les engins, coupaient leurs
cordes, traversaient les mantelets et les palissades.
Voici (17) un ensemble perspectif et des détails de
l'arbalète à tour. On la faisait mouvoir au moyen des
trois roues, dont deux étaient fixées à la
traverse inférieure A et la troisième à la partie
mobile B de l'affût. Un pointail C, posé sur une
crapaudine ovoïde D, ainsi que l'indique le détail C',
maintenait l'affût sur un point fixe servant de pivot. Il
était donc facile de régler le tir sur plan horizontal.
Pour abaisser ou relever le tir, c'est-à-dire pour viser de bas
en haut ou de haut en bas, on pouvait d'abord démonter la roue
extrême E, laisser reposer l'affût sur les deux galets en
olive F; alors le tir prenait la direction F'G (voy. le profil X). Si
on voulait abaisser quelque peu le tir, on relevait la partie
supérieure H de l'affût au moyen de la double
crémaillère K et des deux roues d'engrenage I, auxquelles
on adaptait deux manivelles. S'il était nécessaire
d'abaisser le tir, on laissait la roue E et on élevait la partie
supérieure de l'affût au moyen des
crémaillères. La partie inférieure de
l'affût se mouvait sur le tourillon L. Le propulseur se composait
de deux branches doubles d'acier passées dans des cordages de
nerfs tortillés, comme on le voit dans notre tracé
perspectif, et appuyées à leur extrémité
contre les deux montants du châssis. Pour bander ces cordes de
nerfs autant qu'il était besoin, des tubes de fer étaient
passés entre elles; on introduisait des leviers dans ces tubes,
soit par une de leurs extrémités, soit par l'autre, pour
ne pas permettre aux cordes de se détortiller, et on fixait
l'extrémité de ces leviers aux deux brancards M. Si l'on
sentait que les cordes se détendissent, on appuyait un peu sur
ces leviers en resserrant leurs attaches de manière à ce
que les deux branches de l'arc fussent toujours également
bridées. Pour bander cet arc, dont les deux
extrémités étaient réunies par une corde
faite avec des crins, des nerfs ou des boyaux, on accrochait les deux
griffes N à cette corde; puis, agissant sur les deux grandes
manivelles O, on amenait la corde de l'arc, au moyen des deux
crémaillères horizontales, jusqu'à la double
détente P, laquelle, pour laisser passer la corde, était
rentrée ainsi que l'indique le détail R. Cette
détente était manœuvrée par une tige S
munie, à son extrémité, d'un anneau mobile T, que
l'on passait dans une cheville lorsque la détente était
relevée U. Ramenant alors quelque peu les
crémaillères, la corde venait s'arrêter sur cette
double détente U, qui ne pouvait rentrer dans l'affût. On
appuyait la base du projectile sur la corde en le laissant libre dans
la rainure. Et le pointeur ayant tout préparé faisait
sortir l'anneau T de la cheville d'arrêt, tirait à lui la
tige S; la double détente disparaissait, et la corde revenait
à sa place normale en projetant le dard (voy. le plan Y). Une
légère pression exercée sur le dard par un ressort
l'empêchait de glisser dans sa rainure si le tir était
très-plongeant. Avec un engin de la dimension donnée dans
notre figure, on pouvait lancer de plein fouet un dard de plus de cinq
mètres de long, véritable soliveau armé de fer,
à une assez grande distance, c'est-à-dire à
cinquante mètres au moins, de façon à rompre des
machines, palis, etc. Ces engins lançant des projectiles de
plein fouet étaient ceux qui causaient le plus de
désordre dans les corps de troupes et particulièrement
dans la cavalerie; aussi ne s'en servait-on pas seulement dans les
siéges, mais encore en campagne, au moins pour protéger
des campements ou pour appuyer un poste important.
On se servait aussi d'un engin à ressort, dont la puissance
était moindre, mais dont l'établissement était
plus simple et pouvait se faire en campagne avec le bois qu'on se
procurait, sans qu'il fût nécessaire d'employer ces
crémaillères et toutes ces ferrures qui demandaient du
temps et des ouvriers spéciaux pour les façonner. Cet
engin est fort ancien et rappelle la catapulte des Romains de
l'antiquité. Il se compose (18) d'un arbre vertical cylindrique,
avec une face plate (voy. le plan A) tournant au moyen de deux
tourillons. À la base de cet arbre est fixé un
châssis triangulaire posé sur deux roues et relié
audit arbre par deux liens ou contre-fiches. Des ressorts en bois vert
sont fortement attachés au pied de l'arbre avec des brides en
fer et des cordes de nerfs. Un treuil fixé sur deux montants,
entre les contre-fiches, est mu par des manivelles et roues
d'engrenage. Un bout de corde avec un crochet est fixé à
l'extrémité supérieure du ressort, et une autre
corde, munie d'un crochet à bascule B, s'enroule sur le treuil
après avoir passé dans une poulie de renvoi. Quatre
hommes amènent le ressort. Un dard passe par un trou
pratiqué à l'extrémité supérieure de
l'arbre D, et un support mobile à fourchette E, s'engageant dans
les crans d'une crémaillère F, permet d'abaisser ou de
relever le tir, ainsi que le fait voir le profil G. Lorsque le ressort
est tendu, le pointeur fixe le dard, fait mouvoir le châssis
inférieur sur sa plate-forme suivant la direction du tir et,
appuyant sur la cordelle C, fait sauter le crochet: le ressort va
frapper le dard à sa base et l'envoie au loin dans la direction
qui lui a été donnée. La fig. 19 donne le plan de
cet engin.
L'artillerie à feu était employée que,
longtemps encore, on se servit de ces engins à contre-poids,
à percussion, et de ces arbalètes à tour, tant on
se fiait en leur puissance; et même la première artillerie
à feu n'essaya pas tout d'abord d'obtenir d'autres effets. Les
caables, les pierrières, les trébuchets, les mangonneaux
envoyaient à toute volée de gros boulets de pierre qui
pesaient jusqu'à deux et trois cents livres; ces machines ne
pouvaient lancer des projectiles de plein fouet. On les remplaça
par des bombardes avec lesquelles on obtenait les mêmes
résultats; et les engins à feu envoyant des balles de
but-en-blanc, dès le XIVe siècle, n'étaient que de petites pièces portant des projectiles de la grosseur d'un biscaïen.
[modifier] Engins offensifs à feu
Du jour où l'on eut reconnu la puissance des gaz
dégagés instantanément par la poudre à
canon, on eut l'idée d'utiliser cette force pour envoyer au loin
des projectiles pleins, des boulets de pierre ou des boîtes de
cailloux. On trouva qu'il y avait un grand avantage à remplacer
les énormes et dispendieux engins dont nous venons de donner
quelques exemples par des tubes de fer que l'on transportait plus
facilement, qui coûtaient moins cher à établir et
que l'ennemi ne pouvait guère endommager. Nous n'avons vu nulle
part que la noblesse militaire se soit occupée de perfectionner
les engins de guerre, ou de présider à leur
exécution. Tous les noms d'engingneurs sont des noms roturiers.
Si Philippe-Auguste, Richard Cœur de Lion et quelques autres
souverains guerriers paraissent avoir attaché de l'importance
à la fabrication des engins, ils recouraient toujours à
des maîtres engingneurs qui paraissent être sortis du
peuple. Ce dédain pour les combinaisons qui demandaient un
travail mathématique et la connaissance de plusieurs
métiers, tels que la charpenterie, la serrurerie, la
mécanique, la noblesse l'apporta tout d'abord dans la
première étude de l'artillerie à feu; elle ne
parut pas tenir compte de cette formidable application de la poudre
explosible, et laissa aux gens de métier le soin de chercher les
premiers éléments de l'art du bombardier.
En 1356, le prince Noir assiégea le château de Romorantin; il employa, entre autres armes de jet, des canons
à lancer des pierres, des carreaux et des ballottes pleines de
feu grégeois. Ces premiers canons étaient longs, minces,
fabriqués au moyen de douves de fer, ou fondues en fer ou en
cuivre, renforcés de distance en distance d'anneaux de fer, et
transportés à dos de mulet ou sur des chariots. Ces
bouches à feu, qu'on appelait alors acquéraux, sarres ou spiroles, et plus tard veuglaires,
se composaient d'un tube ouvert à chaque bout; à l'une
des extrémités s'adaptait une boîte contenant la
charge de poudre et le projectile, c'est-à-dire qu'on chargeait
la pièce par la culasse; seulement cette culasse était
complètement indépendante du tube et s'y adaptait au
moyen d'un étrier mobile, ainsi que l'indique la fig. 20. En A,
on voit la boîte et la pièce coupées
longitudinalement; en B, la coupe sur ab; en C, la boîte réunie à la pièce au moyen de l'étrier qui s'arrête sur les saillies dd' des anneaux dentelés; en D, la même boîte se présentant latéralement avec l'étrier e,
muni de sa poignée pour le soulever et enlever la boîte
lorsque la pièce a été tirée. Les points
culminants g réservés sur chacun des anneaux
dentelés servaient de mire. Nous ne savons trop comment se
pointaient ces pièces;
elles étaient probablement suspendues à des
tréteaux par les anneaux dont elles étaient munies. Les
boîtes mobiles adaptées à l'un des bouts du tube
laissaient échapper une partie notable des gaz, et devaient
souvent causer des accidents; aussi on renonça aux boîtes
adaptées, pour faire des canons fondus d'une seule pièce
et se chargeant par la gueule. Il y a quelques années, on a
trouvé dans l'église de Ruffec (Charente) deux canons qui
paraissent appartenir au XIVe
siècle: ce sont des tubes en fonte de fer, sans boîtes,
fermés à la culasse et suspendus par deux anneaux.
Nous donnons (21) ces deux pièces, qui sont d'une petite
dimension; en A, nous avons tracé un fragment de canon qui nous
paraît appartenir à la même époque, et qui a
été trouvé dans des fouilles à
Boulogne-sur-Mer.
En 1380, les Vénitiens se servirent de bouches à feu
dans la guerre contre les Génois, et ces pièces
étaient appelées ribaudequins. Ces premières pièces d'artillerie à feu furent remplacées par les bombardes et les canons.
Dès 1412, l'usage des bombardes et canons faisait
disparaître les engins offensifs pour la défense des
places. «Il résulte, dit Jollois dans son Histoire du siége d'Orléans
(1428), d'un relevé fait avec soin par feu l'abbé Dubois,
qu'en 1428 et 1429 la ville d'Orléans possédait
soixante-onze bouches à feu, tant canons que bombardes, toutes
en cuivre. Dans le nombre de ces bouches à feu sont compris le
canon qui avait été prêté à la ville
d'Orléans par la ville de Montargis, un gros canon qu'on avait
nommé Rifflard21,
une bombarde faite, dit le journal du siége, par un nommé
Guillaume Duisy, très-subtil ouvrier, qui lançait des
boulets de pierre de cent vingt livres pesant, et si énorme
qu'il fallût vingt-deux chevaux22
pour la conduire avec son affût du port à
l'Hôtel-de-ville. Ces deux canons et cette énorme bombarde
étaient mis en batterie sur la tour de la croiche de Meuffray,
sise entre le pont et la poterne Chesneau, d'où ils foudroyaient
le fort des Tournelles dont les Anglais s'étaient
emparés. Parmi les bouches à feu que nous venons
d'indiquer, il faut compter un canon23
qui lançait des boulets de pierre jusqu'à l'île
Charlemagne... Ce ne fut que sous le règne de Louis XI qu'on
substitua des boulets de fer aux boulets de pierre.» Cependant on
employait encore ces derniers à la fin du XVe siècle.
Quoique les noms de canon et de bombarde aient
été donnés indifféremment aux bouches
à feu qui lançaient des boulets de pierre cependant la
bombarde paraît avoir été donnée de
préférence à un canon court et d'un
très-gros diamètre, lançant les projectiles
à toute volée; tandis que le canon, d'un plus faible
diamètre, plus long, pouvait envoyer des boulets de but en blanc.
Ces bombardes sont quelquefois désignées sous le nom de basilics.
Au siége de Constantinople, en 1413, Mahomet II mit en batterie
des bombardes de 200 livres de boulets de pierre. Ces pièces
avaient été fondues par un Hongrois. Une de ces bombardes
était même destinée à envoyer un boulet de
850 livres; deux mille hommes devaient la servir et dix paires de
bœufs la traîner; mais elle creva à la
première épreuve et tua un grand nombre de gens. En 1460,
Jacques II d'Écosse fit fondre une bombarde monstrueuse, qui
creva au premier coup.
Vers cette époque, on renonça aux boîtes emboutiés, mais on fit des canons et bombardes avec boîtes encastrées,
principalement pour les pièces qui n'étaient pas d'un
très-gros diamètre; car pour les bombardes qui portaient
60 livres de balles et plus, on les fabriqua en fonte de fer ou de
cuivre, ou même en fer forgé, en forme de tube, avec un
seul orifice.
Il existe encore quelques bombardes fabriquées au moyen de
douves de fer plat, cerclées par des colliers de fer comme des
barils; peut-être ces pièces sont-elles les plus
anciennes: elles ne se chargeaient pas au moyen de boîtes
à poudre, mais comme nos bouches à feu modernes, si ce
n'est qu'on introduisait la poudre au moyen d'une cuiller, puis une
bourre, puis le boulet, puis un tampon de foin ou d'étoupes,
à l'aide d'un refouloir.
La plus belle bouche à feu que nous connaissions ainsi fabriquée se trouve dans l'arsenal de Bâle
(Suisse) (22). Elle est en fer forgé. La culasse A est
forgée d'un seul morceau; l'âme se compose d'un douvage de
lames de fer de 0,03 c. d'épaisseur sur 0,06 c. de largeur. Ces
douves sont maintenues unies par une suite d'anneaux de fer plus ou
moins épais; en B est un anneau beaucoup plus fort sous lequel
est interposé une bande de cuivre. En C est figurée la
gueule du canon, dont l'âme n'a pas moins de 0,33 c. de
diamètre. La lumière est très-étroite. Dans
le même arsenal, on voit une autre pièce de cuivre de 2m,00 de longueur; elle date de 1444 et porte un écu aux armes de Bourgogne. Pendant le XVe
siècle, on fabriquait des bouches à feu de dimensions
très-variables, depuis le fauconneau, qui ne portait qu'une
livre de balle, jusqu'à la bombarde, qui envoyait des
projectiles en pierre de deux cents livres et plus24.
Ces bombardes n'étaient guère longues en proportion de
leur diamètre et remplissaient à peu près l'office
de mortiers envoyant le projectile à toute volée: elles
se chargeaient par la gueule. On se servait aussi de projectiles creux
que l'on remplissait de matières détonnantes, de feu
grégeois, et c'est une erreur de croire que les bombes sont une
invention des dernières années du XVIe siècle, car plusieurs traités de la fin du XVe et du commencement du XVIe25
nous montrent de véritables bombes faites de deux
hémisphères de fer battu réunis par des brides ou
des frettes (23). À la fin du XVe siècle, les bouches à feu se classent par natures, en raison du diamètre des projectiles; il y a les basilics, qui sont les plus grosses; les bombardes, les ribaudequins, les canons, les dragons volants, scorpions, coulevrines, pierriers, syrènes, passe-murs, passe-avants, serpentines.
Sous Charles VII, l'armée royale possédait
déjà une nombreuse artillerie, et Charles VIII, en 1494,
entra en Italie faisant traîner plus de cent quarante bouches
à feu de bronze montées sur affûts à roues,
traînées par des attelages de chevaux, et bien servies26.
Les Italiens, alors, ne possédaient que des canons de fer
traînés par des bœufs, et si mal servis qu'à
peine pouvaient-ils tirer un coup en une heure.
Examinons maintenant les canons à boîtes encastrées.
L'idée de charger les canons par la culasse était la
première qui s'était présentée, comme ce
sera probablement le dernier perfectionnement apporté dans la
fabrication des bouches à feu. On dut renoncer aux
premières boîtes, qui s'adaptaient mal, laissaient passer
les gaz, envoyaient parfois une grande partie de la charge sur les
servants et se détraquaient promptement par l'effet du recul. On
se contenta de faire dans la culasse du canon une entaille permettant
l'introduction d'une boîte de fer ou de cuivre qui contenait la
charge de poudre maintenue par un tampon de bois. Cette boîte
était fixée de plusieurs manières; elle
était munie d'une anse afin de faciliter sa pose et son
enlèvement après le tir. La balle était
glissée dans l'âme du canon avant l'introduction de la
boîte et refoulée avec une bourre de foin ou de gazon
après cette introduction. Chaque bouche à feu
possédait plusieurs boîtes qu'on remplissait de poudre
d'avance afin de ne pas retarder le tir27.
Chaque boîte était percée d'une lumière
à laquelle on adaptait une fusée de tôle remplie de
poudre que l'artilleur enflammait au moyen d'une baguette de fer rougie
au feu d'un fourneau. Cette méthode avait quelques avantages:
elle évitait l'échauffement de la pièce et les
accidents qui en sont la conséquence; elle permettait de
préparer les charges à l'avance, car ces boîtes
n'étaient que des gargousses encastrées dans la culasse,
comme les cartouches des fusils Lefaucheux, sauf que le boulet
devait être introduit avant la boîte et refoulé
après le placement de celle-ci. Elle avait des
inconvénients qu'il est facile de reconnaître: une partie
considérable des gaz devait s'échapper à la
jonction de la boîte avec l'âme, par conséquent la
force de propulsion était perdue en partie: il fallait nettoyer
souvent le fond de l'encastrement et la feuillure pour enlever la
crasse qui s'opposait à la jonction parfaite de la boîte
avec la pièce; le point de réunion s'égueulait
après un certain nombre de coups, et alors presque toute la
charge s'échappait sans agir sur la balle.
Nous donnons (24) des tracés de ces canons à
boîtes encastrées. En A est une pièce à
encastrement avec joues; la coupe transversale sur l'encastrement est
indiquée en B; la boîte C, portant son anse D et sa
lumière E, est logée à la place qui lui est
destinée; deux clavettes G, passant dans deux trous des joues,
serrent la boîte contre la paroi inférieure de
l'encastrement. En H, nous donnons la coupe longitudinale de la
boîte disposée pour le tir; au moyen de la clavette K, on
a repoussé l'orifice de la boîte dans la feuillure I
pratiquée à l'entrée de l'âme; les deux
clavettes horizontales ont été enfoncées à
coups de marteau. La boîte est pleine de poudre bourrée au
moyen du tampon de bois T; la balle est refoulée. En M, on voit
la boîte déchargée avec son tampon et sa
fusée de lumière O. En P, nous avons figuré un
autre système d'encastrement sans joues, dans lequel la
boîte était repoussée en feuillure de même,
avec une clavette à la culasse, et était maintenue au
moyen d'une seule barre longitudinale pivotant sur un boulon N; une
seule clavette R, passant dans deux œils d'une frette en fer
forgé, serrait cette barre longitudinale.
Dans ce dernier cas, la lumière de la boîte se
présentait latéralement. Il faut croire que les
inconvénients inhérents à ce système le
firent abandonner assez promptement, car on renonça
bientôt à l'emploi de ces bouches à feu à
boîtes pour ne plus employer que les tubes de fonte de cuivre ou
de fer avec un seul orifice. D'ailleurs, si on gagnait du temps en
chargeant d'avance plusieurs boîtes, on devait en perdre beaucoup
à enlever les clavettes et à les renfoncer, sans compter
que les œils de passage des clavettes devaient se fatiguer
promptement, s'élargir et ne plus permettre de serrer
convenablement les boîtes; il fallait alors changer ces clavettes
et en prendre de plus fortes. On voit encore quelques-unes de ces
bouches à feu dans nos arsenaux et au musée d'artillerie
de Paris; quelques-unes sont en fer forgé, les plus grosses sont
en fonte de fer.
Les premières bouches à feu furent montées sur des affûts sans roue et mises simplement en bois, ou charpentées
comme on disait alors, c'est-à-dire encastrées dans un
auget pratiqué dans de grosses pièces de bois et
serrées avec des boulons, des brides de fer ou même des
cordes. Le pointage ne s'obtenait qu'en calant cette charpente en avant
ou en arrière au moyen de leviers et de coins en bois (25). On
disait affûter une bombarde pour la pointer. Du Clercq,
en racontant la mort de Jacques De Lalain, dit que «le mareschal
de Bourgoingne, messire Antoine, bastard de Bourgoingne, messire
Jacques de Lallaing, allèrent (au siége du château
de Poucques) faire affuster une bombarde pour battre ledit chastel; et
comme ils faisoient asseoir la dicte bombarde, ceulx du chastel
tirèrent d'un veuglaire après les dessus dicts seigneurs,
duquel veuglaire ils férirent messire J. de Lallaing et luy
emportèrent le hanepière de la teste...» D'affûter on fit le mot affût, qui, à dater du XVIe
siècle, fut employé pour désigner les
pièces de charpente portant le canon, permettant de le mettre en
batterie et de le pointer.
Les vignettes des manuscrits du milieu du XVe siècle nous donnent un assez grande variété de ces affûts primitifs28.
Sous Charles VII et Louis XI, cependant, l'artillerie de campagne
faisait de rapides progrès; on possédait, à cette
époque déjà, des affûts disposés pour
le tir, permettant de pointer les pièces assez rapidement; mais
on était encore loin d'avoir imaginé l'avant-train
mobile, et, lorsqu'on transportait des bouches à feu, il fallait
les monter sur des chariots spéciaux indépendants des
affûts. Pendant une bataille, on ne pouvait faire manœuvrer
l'artillerie, sauf quelques petits canons, comme on le fait depuis deux
cent cinquante ans. Les artilleurs se défiaient tellement de
leurs engins (et certes c'était à bon escient), qu'ils
cherchaient à se garantir contre les accidents
très-fréquents qui survenaient pendant le tir. Non
contents d'encastrer les bouches à feu dans de grosses
charpentes et de les y relier solidement pour les empêcher de
crever ou pour rendre au moins l'effet de la rupture de la pièce
moins dangereux, ils fixèrent souvent leurs gros canons, leurs
bombardes, dans des caisses composées d'épais madriers
solidement reliés. Ces caisses formaient autour de la
pièce une garde qui, en cas d'accident, préservait les
servants. Au moment du tir, chacun se baissait, et l'artilleur
chargé de mettre le feu à l'aide d'une longue broche de
fer rougie à l'une de ses extrémités se
plaçait à côté de l'encaissement.
Voici (26) un de ces affûts-caisses. La bouche à feu
était inclinée afin d'envoyer le projectile à
toute volée; sa gueule étant encastrée dans le
bord antérieur de la caisse et sa culasse posant sur le fond. En
A, on voit la coupe transversale de la pièce dans son
encaissement et la disposition des cordes qui la maintiennent fixe. Le
recul de la pièce était évité au moyen des
piquets B enfoncés en terre. En C est placé le fourneau
propre à chauffer les lances à bouter le feu. La charge
de poudre était introduite au moyen de grandes cuillers en fer
battu. On conçoit qu'un pareil engin devait être peu
maniable et qu'on ne pouvait que l'affûter une fois,
c'est-à-dire le mettre en position de manière à
envoyer les projectiles sur un même point: aussi ces
pièces n'étaient-elles employées que dans les
siéges et ne s'en servait-on pas en campagne. Si les artilleurs
prétendaient se garder des éclats d'une bouche à
feu défectueuse, ils pensaient aussi à se mettre à
l'abri des projectiles ennemis. À cet effet, d'épais
mantelets en bois étaient dressés devant les
pièces d'artillerie. Ces mantelets roulaient sur un axe
horizontal, étaient relevés au moment du tir, et
retombaient verticalement par leur propre poids lorsque la pièce
était déchargée, de manière à la
masquer complètement ainsi que les servants occupés
à la recharger (27)29.
On fabriquait aussi alors des affûts triangulaires, plus
maniables que les précédents et permettant de pointer
dans l'étendue d'un certain arc de cercle. Ces
affûts-caisses triangulaires étaient fixés au
sommet du triangle au moyen d'un pivot et se manœuvraient
à l'aide de deux roulettes engagées aux
extrémités des branches latérales. Mais on allait
renoncer à ces bombardes d'un énorme diamètre
propres seulement à lancer des boulets de pierre: on adoptait
les boulets de fer, on brûlait une quantité de poudre
moins considérable, et les bouches à feu n'atteignaient
plus ces proportions colossales qui en rendaient le transport difficile.
À la fin du XVe siècle et au commencement du XVIe, on fondit des canons de bronze d'une dimension et d'une beauté remarquables. Il existe, dans l'arsenal de Bâle, un de ces grands canons de 4m,50
c. de longueur, couvert d'ornements et terminé par une
tête de dragon; il fut fondu à Strasbourg en 1514.
Fleurange, dans ses Mémoires, chap. VII, dit qu'en 1509 les
Vénitiens, à la bataille d'Aignadel, perdue contre les
Français, possédaient «soixante grosses
pièces, entre lesquelles il y en avoit une manière plus
longue que longues couleuvrines, lesquelles se nomment basilics, et
tirent boulets de canon; et avoit dessus toutes un lion, ou avoit
écrit, à l'entour du dit lion, Marco.»
Vers cette époque, on se servait déjà de mortiers propres à lancer de gros boulets de pierre ou des bedaines
remplies de matières inflammables. Un tableau peint par Feselen
(Melchior), mort en 1538, et faisant partie aujourd'hui de la
collection déposée dans la Pinacothèque de Munich
(nº 30), représentant le siége d'Alesia par
Jules-César, nous montre un gros mortier monté sur
affût dans lequel un artilleur dépose un projectile
sphérique (28). Les deux roues ont été
enlevées et gisent à terre des deux côtés de
l'affût. Le mortier paraît ainsi reposer sur le sol, et on
lui donnait l'angle convenable à l'aide de leviers et de coins
glissés sous la culasse. On se servait aussi, à la fin du
XVe siècle et dès le temps de Louis XI, de projectiles de fer rougis au feu. Georges Chastelain30
dit qu'au siége d'Audenarde les Gantois «battirent de
leurs bombardes, canons et veuglaires, ladite ville, et entre les
autres, firent tirer de plusieurs gros boulets de fer ardent du gros
d'une tasse d'argent, pour cuider ardoir la ville.»
Mais revenons aux affûts. Afin de rendre le pointage des
pièces possible soit verticalement, soit horizontalement, on
adapta d'abord deux roues à la partie antérieure de
l'affût, et on divisa celui-ci en deux pièces
superposées, celle du dessus pouvant décrire un certain
arc de cercle (29). Le canon était encastré et maintenu
dans des pièces de bois assemblées jointives, pivotant
sur un boulon horizontal C posé sous la bouche. La queue
très-allongée de ces pièces de bois faisait
levier, était soulevée et arrêtée plus ou
moins haut à l'aide de broches de fer passées dans la
double crémaillère B. Ainsi la queue pouvait être
élevée jusqu'en A'. La partie inférieure fixe de
l'affût reposait à terre et était armée de
deux pointes de fer D destinées à prévenir les
effets du recul. En E est représenté le bout
inférieur de l'affût avec ses deux pointes et les deux
membrures superposées. Toutefois, les membrures
supérieures recevant la bouche à feu, si longue que
fût la queue, il n'en fallait pas moins beaucoup d'efforts pour
soulever cette masse, ce qui rendait le pointage fort lent. D'ailleurs,
pour faire glisser jusqu'à la charge de poudre les
énormes boulets de pierre qu'on introduisait alors dans les
bombardes, il était nécessaire de donner une inclinaison
à la pièce, de la gueule à la culasse; il fallait,
après chaque coup, redescendre la membrure supérieure de
l'affût sur celle inférieure, charger la pièce,
puis pointer de nouveau en relevant la queue de la membrure au point
voulu. On chercha donc à rendre cette manœuvre plus
facile. Au lieu de faire mouvoir toute la membrure supérieure
sur un axe placé sous la gueule de la pièce, ce fut la
partie inférieure de l'affût qu'on rendit mobile, et au
lieu de placer le boulon en tête, on le plaça au droit de
la culasse (30): l'effort pour soulever la pièce était
ainsi de beaucoup diminué, parce que le poids de celle-ci se
trouvait toujours reporté sur l'essieu, et que plus on soulevait
la queue de l'affût, moins le poids du canon agissait sur la
membrure. Ces divers systèmes furent abandonnés vers
1530; alors, outre les deux roues, on en ajouta une troisième
à la queue; c'est ce qui fut cause qu'on sépara celle-ci
en deux forts madriers de champ (les flasques) entre lesquels on
monta cette troisième roue. On pointa la pièce, non plus
en relevant l'affût, mais en agissant à l'aide de coins ou
de vis sous la culasse du canon, maintenu sur l'affût au moyen de
tourillons; car on observera que, jusque vers le milieu du XVIe
siècle, les bouches à feu étaient privées
de tourillons et d'anses, qu'elles n'étaient maintenues dans
l'encastrement longitudinal de l'affût que par des brides en fer
ou même des cordes.
À la fin du XVIe siècle, les pièces d'artillerie de bronze étaient divisées en légitimes et bâtardes: les légitimes présentaient les variétés suivantes: le dragon,
ou double coulevrine, envoyant 40 livres de balle de fer et portant
à 1364 pas de deux pieds et demi de but en blanc; la coulevrine légitime, dite ordinaire, envoyant 20 livres de balle de fer et portant à 1200 pas, id.; la demi-coulevrine, envoyant 10 l. de balle de fer et portant à 900 pas, id.; le sacre ou quart de coulevrine, envoyant 5 l. de balle de fer et portant à 700 pas, id.; le fauconneau, ou huitième de coulevrine, envoyant 2 l. 1/2 de balle de fer et portant à 568 pas, id.; le ribaudequin, envoyant 1 l. 4 onces de balle de fer et portant à 411 pas, id.; l'émerillon, envoyant 15 onces de plomb et portant à 315 pas, id. Les pièces bâtardes comprenaient: le dragon volant,
ou double coulevrine extraordinaire, envoyant 32 l. de balle de fer et
portant à 1276 pas de 2 pieds et demi de but en blanc; le passe-mur, envoyant 16 l. de balle et portant à 1120 pas, id.; le passe-volant, envoyant 8 l. de balle et portant à 840 pas, id.; le sacre extraordinaire, envoyant 4 l. de balle et portant à 633 pas, id.; le fauconneau extraordinaire, envoyant 2 l. de balle et portant à 498 pas, id.; le ribaudequin ou passager, envoyant 1 l. de balle et portant à 384 pas, id.; l'émerillon, envoyant 1/2 l. de balle et portant à 294 pas, id. Il y avait encore les canons, qui comprenaient: le canon commun, dit sifflant ou batte-mur, envoyant 48 l. de balle et portant à 1600 pas de 2 pieds et demi de but en blanc; le demi-canon, envoyant 16 l. de balle et portant à 850 pas, id.; le quart de canon, dit persécuteur, envoyant 12 l. de balle et portant à 750 pas, id.; le huitième de canon, envoyant 6 l. de balle et portant à 640 pas, id. Il y avait aussi quelques canons bâtards appelés rebuffés, crépans, verrats,
les crépans étant des demi-canons et les verrats des
quarts de canon, mais un peu plus longs que les canons ordinaires.
Nous ne croyons pas nécessaire de parler ici des
singulières inventions auxquelles recouraient les artilleurs
à la fin du XVe siècle et au commencement du XVIe,
inventions qui n'ont pu que causer de fâcheux accidents et faire
des victimes parmi ceux qui les mettaient à exécution;
tels sont les canons coudés, les canons rayonnants avec une
seule charge au centre, les jeux d'orgues en quinconce, etc.
[modifier] Engins offensifs et défensifs
Nous rangeons tout d'abord dans cette série d'engins les béliers couverts, moutons, bossons,
qui étaient en usage chez les Grecs, les Romains de
l'antiquité, ainsi que chez les Byzantins, et qui ne
cessèrent d'être employés qu'au commencement du XVIe siècle, car on se servait encore des béliers pendant le XVe siècle; les chats, vignes et beffrois.
Le bélier ou le mouton consistait en une longue poutre
armée d'une tête de fer à son
extrémité antérieure, suspendue en
équilibre horizontalement à des câbles ou des
chaînes, et mue par des hommes au moyen de cordes fixées
à sa queue. En imprimant un mouvement de va-et-vient à
cette pièce de bois, on frappait les parements des murs, que
l'on parvenait ainsi à disloquer et à faire crouler. Les
hommes étaient abrités sous un toit recouvert de peaux
fraîches, de fumier ou de gazon, tant pour amortir le choc des
projectiles que pour éviter l'effet des matières
enflammées lancées par les assiégés.
L'engin tout entier était posé sur des rouleaux ou des
roues, afin de l'approcher des murs au moyen de cabestans ou de
leviers. Les assiégés cherchaient à briser le
bélier au moyen de poutres qu'on laissait tomber sur sa
tête au moment où il frappait la muraille; ou bien ils
saisissaient cette tête à l'aide d'une double
mâchoire en fer qu'on appelait loup ou louve31.
Le bélier s'attaquait aux portes et les avait bientôt
brisées. Au siége de Châteauroux, Philippe-Auguste,
après avoir investi la ville, attache les mineurs au pied des
remparts, détruit les merlons au moyen de pierrières,
dresse un bélier devant la porte «toute doublée de
fer», fait avancer des tours mobiles en face des défenses
de l'ennemi, couvre les parapets d'une pluie de carreaux, de
flèches et de balles de fronde32.
L'effet du bélier était désastreux pour les
remparts non terrassés; on ouvrait des brèches assez
promptement, au moyen de cet engin puissant, dans des murs
épais, si les assiégés ne parvenaient pas à
neutraliser son action répétée; aussi les
assiégeants mettaient-ils tout leur soin à bien
protéger cette poutre mobile ainsi que les hommes qui la
mettaient en mouvement. Pour offrir le moins de prise possible aux
projectiles des assiégés, on donnait à la
couverture du bélier beaucoup d'inclinaison; on en faisait une
sorte de grand toit aigu à deux pentes, avec une croupe vers
l'extrémité postérieure, le tout recouvert de
très-forts madriers renforcés de bandes de fer et
revêtu, comme il est dit ci-dessus, de peaux de cheval ou de
bœuf fraîches, enduites de terre grasse pétrie avec
du gazon ou du fumier.
La fig. 31 montre la charpente de cet engin dépouillée
de ses madriers et de ses pannes. Le bélier A, poutre de 10m,00
de long au moins, était suspendu à deux chaînes
parallèles B attachées au sous-faîte, de
manière à obtenir un équilibre parfait. Pour
mettre en mouvement cette poutre et obtenir un choc puissant, des
cordelles étaient attachées au tiers environ de sa
longueur en C; elles permettaient à huit, dix ou douze hommes,
de se placer à droite et à gauche de l'engin; ces hommes,
très-régulièrement posés,
manœuvraient ainsi: un pied D restait à la même
place, le pied droit pour les hommes de la droite, le pied gauche pour
ceux de la gauche. Le premier mouvement était celui
figuré en E; il consistait, la poutre étant dans sa
position normale AH, à la tirer en arrière; après
quelques efforts mesurés, la poutre arrivait au niveau A'H'.
Alors le second mouvement des servants était celui F. La poutre
parcourait alors tout l'espace. Le troisième mouvement est
indiqué en G. La tête H du bélier rencontrant la
muraille comme obstacle, les servants continuaient la manœuvre
avec les deux premiers mouvements, celui E et celui F. On comprend
qu'une course KL faite par une poutre de 10m,00 de long
devait produire un terrible effet à la base d'une muraille. La
tête de la poutre était armée d'une masse de fer
ayant à peu près la forme d'une tête de mouton
(voy. le détail P).
Les chats et vignes33
n'étaient autre chose que des galeries de bois recouvertes de
cuirs frais, que l'on faisait avancer sur des rouleaux jusqu'aux pieds
des murailles, et qui permettaient aux mineurs de saper les
maçonneries à leur base. Nous avons
représenté un de ces engins dans l'article Architecture Militaire,
fig. 15. Ces chats servaient aussi à protéger les
travailleurs qui comblaient les fossés. Souvent les beffrois ou
tours mobiles en bois que l'on dressait devant les remparts
assiégés tenaient lieu de chats à leur partie
inférieure; aussi, dans ce cas, les nommait-on chas-chastels. Cet engin monstrueux était employé par les Romains, et César en parle dans ses Commentaires. On ne manqua pas d'en faire un usage fréquent pendant les siéges du moyen âge. Suger raconte, dans son Histoire de la vie de Louis le Gros,
que ce prince, assiégeant le château de Gournay,
après un assaut infructueux, fit fabriquer «une tour
à trois étages, machine d'une prodigieuse hauteur, et
qui, dépassant les défenses du château,
empêchait les frondeurs et les archers de se présenter aux
créneaux... À l'engin colossal était fixé
un pont de bois qui, s'élevant au-dessus des parapets de la
place, pouvait, lorsqu'on l'abaissait, faciliter aux assiégeants
la prise des chemins de ronde.» Dans le poëme, du XIIe siècle, d'Ogier l'Ardenois,
Charles, assiégeant le château dans lequel Ogier est
enfermé, mande l'engigneor Malrin, qui ne met que quinze jours
à prendre la place la plus forte. Cet engigneor occupe trois
cent quatre-vingts charpentiers à ouvrer un beffroi d'assaut:
«Devant la porte lor drecha un engin34
Sor une estace l'a levé et basti,
À sept estages fu li engins furnis,
Amont as brances qi descendent as puis,
Fu ben cloiés et covers et porpris,
Par les estages montent chevalier mil,
Arbalestrier cent soixante et dix.
...
Et l'engigneres qi ot l'engin basti,
Il vest l'auberc, lace l'elme bruni,
El maistre estage s'en va amont séir.»
L'auteur, en sa qualité de poëte, peut être
soupçonné de quelque exagération en faisant entrer
1170 hommes dans son beffroi; mais il ne prétend pas qu'il
fût mobile. Plus loin, cependant, il dit:
«De l'ost a fait venir les carpentiers35,
Un grant castel de fust fist comenchier Sus quatre roes lever et
batiller, Et el marès fist les cloies lancier, Que ben i passent
serjant et chevalier. ...»
On lit aussi, dans le Roman de Brut, ce passage:
«Le berfroi fist al mur joster (approcher)
Et les périères fist jeter36.»
Et dans le continuateur de Ville-Hardouin: «Dont fist Hues
d'Aires (au siége de Thèbes) faire un chat, si le fist
bien curyer (couvrir de cuirs) et acemmer; et quant il fu tou fais, si
le fisent mener par desus le fossé...»
Les exemples abondent. Ces beffrois, castels-de-fust, chas-chastiaux,
étaient souvent façonnés avec des bois verts,
coupés dans les forêts voisines des lieux
assiégés37,
ce qui rendait leur destruction par le feu beaucoup plus difficile. Ils
étaient ordinairement posés sur quatre roues et mus au
moyen de cabestans montés dans l'intérieur même de
l'engin, à rez-de-chaussée. Au moyen d'ancres ou de
piquets et de câbles, on faisait avancer ces lourdes machines
exactement comme on fait porter un navire sur ses ancres. Le terrain
était aplani et garni de madriers jusqu'au bord du fossé.
Celui-ci était comblé, en ménageant une pente
légère de la contrescarpe au pied de la muraille. Le
remblai du fossé couvert également de madriers, lorsque
le beffroi était amené à la crête de la
contrescarpe, on le laissait rouler par son propre poids, en le
maintenant avec des haubans, jusqu'au rempart attaqué. Le talent
de l'engingneur consistait à bien calculer la hauteur de la
muraille, afin de pouvoir, au moment opportun, abattre le pont sur le
crénelage. Une figure nous est ici nécessaire pour nous
faire comprendre. Soit (32) une muraille A qu'il s'agit de forcer.
Avant tout, au moyen des projectiles lancés par les
trébuchets et mangonneaux, les assiégeants ont
détruit ou rendu impraticables les hourds B, ils ont
comblé le fossé D et ont couvert le remblai d'un bon
plancher incliné. Le beffroi, amené au point C,
engagé sur ce plancher, roule de lui-même; les
éperons E, dont la longueur est calculée, viennent butter
contre le pied de la muraille; leurs contre-fiches G, couvertes de
forts madriers, forment un chat propre à garantir les
pionniers et mineurs, s'il est besoin. Alors le pont H est abattu
brusquement; il tombe sur la crête des merlons, brise les
couvertures des hourds, et les troupes d'assaut se précipitent
sur le chemin de ronde K. Pendant ce temps, des archers et des
arbalétriers, postés en I au dernier étage,
couvrent ces chemins de ronde, qu'ils dominent, de projectiles, pour
déconcerter les défenseurs qui de droite et de gauche
s'opposeraient au torrent des troupes assaillantes. Outre les escaliers
intérieurs, au moment de l'assaut de nombreuses échelles
étaient posées contre la paroi postérieure L du
beffroi, laissée à peu près ouverte. Nous avons
supprimé, dans cette figure, les madriers et peaux
fraîches qui couvraient la charpente, afin de laisser voir
celle-ci; mais nous avons donné, dans l'article Architecture Militaire, fig. 16, un de ces beffrois garni au moment d'un assaut. Vers le milieu du XVe
siècle, on plaça de petites pièces d'artillerie au
sommet de ces beffrois et sur le plancher inférieur pour battre
le pied des murs et couvrir les chemins de ronde de mitraille38.
Parmi les engins propres à donner l'assaut, il ne faut pas
négliger les échelles qui étaient
fréquemment employées et disposées souvent d'une
façon ingénieuse. Galbert, dans sa Vie de Charles le Bon,
parle d'une certaine échelle faite pour escalader les murs du
château de Bruges, laquelle était très-large,
protégée par de hautes palissades à sa base et
munie à son sommet d'une seconde échelle plus
étroite devant s'abattre en dedans des murs. Les palis
garantissaient les assaillants qui se préparaient à
monter à l'assaut; l'échelle se dressait à l'aide
d'un mécanisme, et, une fois dressée, la seconde
s'abattait.
On lit, dans le roman d'Ogier l'Ardenois, ces vers:
«Vés grans alnois (aulnes) en ces marés plantés;
Faites-les tost et trancher et coper,
Caisnes et saus (chênes et saules) ens el fossé jeter,
Et la ramille (branchage) e quanc'on puet trover,
Tant que pussons dessi as murs aler;
Et puis ferés eskeles carpenter,
Sus grans roeles dessi as murs mener;
En dix parties et drechier et lever39.
...
Dix grans eskeles fist li rois carpenter,
Sus les fosseis et conduire et mener,
Puis les ont fait contre les murs lever:
De front i poent vingt chevaliers monter40.»
L'échelle, munie d'étais mobiles, paraît avoir
été, de toutes celles employées dans les assauts,
la plus ingénieuse. La fig. 33 en donne le profil en A. Tout le
système était posé sur un châssis à
roues que l'on amenait près du pied de la muraille à
escalader; il se composait de deux branches d'échelle BC, munies
de roulettes B à la base, réunies par un boulon; ces
roulettes, faites comme des poulies, ainsi que l'indique le
détail O, s'engageaient sur les longrines DE du châssis;
à deux boucles en fer P, maintenues à
l'extrémité du boulon, s'attachaient deux cordages qui
passaient dans les poulies de renvoi F et venaient s'enrouler sur le
treuil G. En appuyant sur ce treuil au moyen des deux manivelles, on
amenait les pieds B de l'échelle en B'. Alors les deux
étais à pivot HI se relevaient en HI';
c'est-à-dire que le triangle BHI devenait le triangle B'HI', sa
base étant raccourcie, et le sommet de l'échelle C, qui
reposait sur une traverse K, s'élevait en C'. On tirait alors
sur le fil L et on abattait le double crochet en fer, roulant au sommet
de l'échelle, sur les merlons du rempart à escalader, de
façon à fixer l'engin (voy. le détail R). Les
hommes qui étaient chargés d'appuyer sur le treuil G
s'avançaient à mesure que le pied de l'échelle se
rapprochait du point B'. Ces sortes d'échelles étaient
assez larges pour que trois hommes pussent monter de front à
l'assaut. Solidement amarrées à leur pied, maintenues
vers le milieu par les deux étais à pivot,
accrochées à leur sommet aux parapets, il fallait des
moyens puissants pour déranger ces échelles. D'ailleurs,
pendant cette manœuvre et pendant l'assaut, les
assiégeants couvraient les remparts d'une nuée de
projectiles, et on avait le soin d'entourer l'engin de grands mantelets
de claies. On se servait aussi d'échelles qui se montaient par
pièces, qui s'emboutissaient et pouvaient ainsi être
apportées facilement au pied des remparts pour être
dressées en peu de temps. Les ouvrages des XVe et XVIe
siècles sur l'art militaire sont remplis de modèles
d'engins de guerre et notamment de diverses inventions
d'échelles qu'il serait impossible de mettre en pratique; aussi
n'en parlerons-nous pas ici, d'autant que dans les siéges
où les échelades sont employées, comme sous
Charles V, par exemple, et pendant la guerre de l'indépendance,
les armées assiégeantes ne paraissent s'être
servies que d'échelles ordinaires pour escalader les remparts.
La question, alors comme aujourd'hui, était d'apporter un assez
grand nombre d'échelles, et assez promptement pour
déconcerter les défenseurs et leur ôter la
possibilité de les renverser toutes à la fois.
[modifier] Engins défensifs
Les seuls engins défensifs employés pendant le moyen
âge sont les mantelets. Les Romains s'en servaient toujours dans
les siéges et les formaient de claies posées en
demi-cercle et montées sur trois roues (34), ou encore de
panneaux assemblés à angle droit, également
montés sur trois roues (35). Pendant le moyen âge, on
conserva ces usages, qui s'étaient perpétués dans
les armées. Les archers et
arbalétriers qui étaient chargés de tirer sans
cesse contre les créneaux d'un rempart attaqué pendant le
travail des mineurs ou la manœvre des engingneurs occupés
à faire avancer les beffrois, les chats et les échelles,
se couvraient de mantelets légers tels que ceux
représentés dans les fig. 36 et 37. Ces tirailleurs
devaient sans cesse changer de place, pour éviter les
projectiles des assiégés; il était
nécessaire que les mantelets leur servant d'abri fussent
facilement transportables. Nous donnons, dans l'article Siége, les dispositions d'ensemble de ces moyens d'attaque et de défense. Avant nous, un auteur illustre41
avait reconnu la valeur de ces engins de guerre du moyen âge et
combien peu jusqu'alors ils avaient été
étudiés et appréciés; nous devons à
la vérité de dire que ces premiers travaux nous ont mis
sur la voie des quelques aperçus nouveaux
présentés dans cet article. Mais l'art de la guerre au
moyen âge mériterait un livre spécial; nous serions
heureux de voir ce côté si peu connu de
l'archéologie mis en lumière par un auteur
compétent en ces matières.